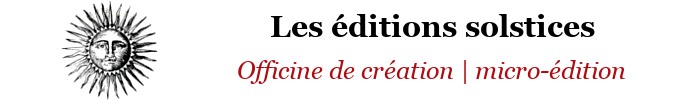Nous proposons ici la traduction de la préface à quelques poèmes de Sylvia Plath, traduits de l’anglais vers l’italien par Amelia Rosselli et parus chez Mondadori en 1980, puis 1991.
Article aux résonances particulières, quand on connaît les similitudes entre la vie des deux poétesses. Qu’on nous permette ici de les rappeler, puisque Amelia Rosselli reste encore une inconnue auprès du public français. Sylvia Plath perd son père à 9 ans, Amelia Rosselli à 7 ans. …
Ainsi, nous ne pouvons nous empêcher de lire cet article comme un portrait projeté, une auto-analyse par l’autre, tout en faisant la part entre ce qui appartient en propre à l’une et à l’autre.
Tout simplement féroce, le rapport que Rossana Rossanda imaginait entre la poétesse Sylvia Plath et sa mère dans son compte-rendu du volume Lettres à la mère publié en 1979 chez Guanda. Il me semble qu’alors Rossenda tendait à politiser le sujet à tel point qu’elle en donnait une interprétation violemment altérée et déformée en partie par une superposition pseudo-féministe et pseudo-psychologique. Son article sortit dans « L’espresso » du 4 novembre 1979, accompagné de belles et précieuses photographies, mais il se fourvoyait quant au sujet sur lequel il portait une ironique voire une cruelle analyse : c’est-à-dire le rapport mère-fille dans l’Amérique d’après-guerre. Moins trompeuse cependant était son énergique analyse prise dans un sens socio-politique ; si ce n’est qu’il traitait d’une jeune fille, poétesse de génie, une des meilleures sans conteste de cette moitié de siècle dans un Occident travaillé par les crises « au féminin », et d’une mère accusée avant tout en tant qu’Américaine, et parce qu’il y avait une histoire de suicide (la Plath, qui était née en 1932 à Boston, mit fin à ses jours en 1963 à Londres), et enfin parce que mère et fille étaient d’extraction visiblement « bourgeoise » et typiquement et de manière conformiste « in », aspirant au succès (pauvres petites, dans les études !) entre un collège et un autre (Smith dans le Massachusetts et Cambridge en Angleterre).
Qui était Sylvia Plath ? Et qui était sa mère ? De cette dernière, Aurelia Schober, on sait seulement que, d’une origine petite bourgeoisie, après être devenue veuve, elle se consacra à sa passion pour les lettres, même si elle la sacrifia en partie pour lier sa famille à un Allemand polonais spécialiste de biologie et de psychologie sociale et méticuleux observateur de la vie des abeilles. Si sa fille écrivit près de 700 lettres entre ses dix-huit et ses trente ans ce fut, comme l’affirme Aurelia Schober, parce que « nous ne pouvions pas nous permettre des appels longue distance » et parce que aussi Sylvia aimait écrire. Si la Rossanda analysait l’esprit typiquement optimiste et pseudo-candide des lettres de Sylvia à sa mère, écrites dans ce style particulier que beaucoup de jeunes filles américaines pensent devoir prendre pour remonter le moral de leurs mères restées seules, et spécialement dans ces lettres écrites entre vingt et vingt-quatre ans, c’est parce qu’en un certain sens il lui « convenait » d’analyser le rapport mère-fille en un seul sens : en oubliant que quand la Plath se maria, le style de ses lettres acquit à la fois un ton calme et réflexif et non plus jubilatoire.
Plath est étudiée non pour cette soi-disant typicité de jeune fille américaine toute succès, dépressions et vagues tentatives de suicide (à la mode aussi ici en Europe), mais au contraire pour sa grandeur auto-délimitée et pour l’inactualité de sa poésie, traduite en partie par Giovanni Giudici (Lady Lazarus e altre poesie, Mondadori 1978).
Rossanda, bien que mettant le doigt dans la plaie en ce qui concerne la malheureuse-heureuse jeunesse américaine de Sylvia Plath (qui s’efforçait de cacher sa diversité de créatrice et d’artiste dans des milieux qui favorisaient peu l’excentricité de son talent), ne relève pas que le roman à moitié biographique de Plath (La campana di vetro de 1961-63, trad. Italienne Mondadori 1968), écrit pour des raisons hélas commerciales, fut nettement répudié par la poétesse elle-même, qui en avertit sa mère. Et Aurelia Schober fit bien – enseignante au lycée, puis secrétaire et sténographe – à chercher, après la mort de Sylvia, à retirer de la circulation, non parce que, comme le soutient la Rossanda, il y eût (en un seul point) ressentiment de la fille envers elle, mais surtout parce qu’il évident que le style et l’analyse de cette biographique commercialisée est d’une telle discordance par rapport à la haute valeur et à l’enviable acuité de la poésie de la Plath, qu’on reste éberlué que l’auteure se soit aussi ingénument vendue pour les quelques sous qu’un roman, et en fait même pas un grand best-seller, pouvait lui rapporter.
Dans tout le roman il n’y a seulement qu’une seule et longue séquence d’un certain niveau psychologique et littéraire, et c’est la description précise et honnête d’une crise suicidaire méditée en partie inconsciemment par un jeune homme de dix-neuf ans pendant un chaud été dans un petit et ennuyeux village de l’arrière-pays bostonien. Le reste, surtout stylistiquement, est médiocre, et malheureusement, plutôt que d’étudier à fond même philologiquement la surprenante limpidité des quatre recueils de la poétesse, il est à la mode dans beaucoup de pays d’en étudier la biographie (du reste artificielle et comme « reflétée » dans les lettres un peu forcées et convenues à sa mère, et par le roman écrit à la va-vite pour de l’argent et pour des raisons commerciales). Et il est à la mode aussi de l’étudier selon des clefs lourdement féministes, adjectif en fait non pertinent – sauf indirectement – à la thématique de la Plath (son féminisme qui pointe plutôt dans les choix thématiques, et dans la « pratique » objectale et un peu glacée des métaphores).
À l’analyse de chacun des quatre recueils de vers de la Plath écrits entre 1960 et 1962, on remarquera que la classification n’est même pas adaptée que, par commodité, on utilise souvent pour son travail, c’est-à-dire celle de « confessionnelle ». Et malheureusement, que ce soit dans les éditions mondadorines, même si ce n’est pas le cas dans le second volume (Le muse inquietanti, sous la direction de Gabriella Morisco, traduction de G. Morisco et A. Rosselli, Mondadori 1985), ou dans d’autres recueils partiaux, ou dans des revues féministes peu ou prou, l’attention est toute tendue vers ces deux ou trois poèmes parmi la cinquantaine de chaque recueil, qui s’inspirent véritablement de faits autobiographiques. Les plus belles poésies de Plath sont en revanche justement celles dans lesquelles elle se transcende elle-même, où son petit moi torturé et casanier (études, récompenses, carrière, mari, enfants, amies) disparaît délibérément, et par choix conscient d’auteur, en face de thèmes bien plus urgents, et sans l’éternelle « plainte » qui nous a si longtemps oppressés aussi bien dans la poésie de la soi-disant jeune rebelle mais en fait repliée sur le « privé », que dans certaines protestations malheureusement pleines de ressentiment et presque d’un racisme féministe. Ce fut justement la mère Aurelia à s’opposer publiquement à l’exploitation de la poésie de Sylvia de la part des mouvements féministes après sa mort aux États-Unis. Robert Lowell, le poète fondateur du style « confessionnel » auprès de qui Plath brièvement étudia, surpasse lui aussi dans ses années de maturité l’autobiographisme désormais usé pour une réflexion plus attentive et universelle (dans ce cas aussi, après un changement de résidence dans le Kent, en Angleterre).
Une thématique qui est constamment délaissée quand on enquête sur les causes de la fin tragique de Plath est celle de sa peut-être trop optimiste tentative de concilier une vie pleinement matrimoniale avec l’activité créatrice au sens large. La Plath était trop persuadée que famille et création artistique pouvaient coexister : en revanche elle se choisit pour compagnon un mentor plus qu’un mari, le poète aujourd’hui célèbre Ted Hughes. De ma connaissance du milieu littéraire et universitaire londonien j’ai appris que la faillite du mariage de Plath fut causé surtout, dans sa phase finale, par un intolérable climat de compétition qui peu à peu s’était instauré entre eux deux. Que ce soit l’ami Alvarez (auteur d’un essai critique Le Dieu sauvage – le suicide comme art, Rizzoli 1971), ou Ted Hugues, ils ont fini par abandonner la Plath, l’un d’une manière, l’autre d’une autre, quand elle mit en scène une seconde tentative de suicide.
Qu’ensuite la recherche artistique à ce haut niveau auquel l’a porté Plath, et à une telle intensité, soit un risque mortel en soi, malheureusement tout artiste le sait bien dès le début de sa vocation à faire des expérimentations avec la vie ; aussi bien que toute femme sait que la vie matrimoniale, les métiers de la maison, les enfants, le soutien au mari (peut-être pas de la même profession !) et l’indépendance économique ne coïncident pas toujours avec la pleine réalisation d’une vocation créative. On pourrait étudier autant que l’on voudra l’adolescence, les lettres et la biographie de Plath sans jamais trouver autre chose que des « miroirs » grossissants et déformants. Bien plus clairs ses vers, et plus honnêtes. Qui s’arrête d’insister sur des poésies intitulées Papa, Lady Lazarus, Lesbo, Ourlet, Mort & C., Trois femmes (drame pour la radio), qui sont dorénavant choisies par tout le monde dans une espèce de frénésie tardive pour le psychologique, l’horrible, le privé, la cause cachée, se rappellera en revanche que toutes les meilleures poésies de la Plath ont pour titre des phrases ou des vocables poétiquement neutres ou ambigus, comme Le jardin du manoir, Les Hauts d’Hurlevent, Automne de la grenouille, Les cloches de Parliament Hill, La corneille du temps pluvieux, Inquiétude, Mystique, Amnésique, Talidomide, Ariel, La lune et l’enclume, Petite fugue. Déjà de ces titres et de leurs thèmes sous-entendus, on devinerait que la Plath est mystique et en même temps concrète dans la métaphore, comme dans son langage sec et musical, digne héritière de Shelley et de Keats, ou de Blake et de Dickinson, et que ses petites origines bourgeoises ne sont pas démenties par une poignée de lettres à moitié humoristiques, émus au contraire par l’estime et la gentillesse du rapport qui se révèle envers une mère assez cultivée pour en comprendre la générosité.
Si vraiment nous devons commenter dans un sens psycho-biographique les lettres et la vie de Sylvia Plath, nous pouvons seulement ajouter que ce n’est sûrement pas la mère Aurelia qui doit être retenue pour responsable, comme il est arrivé à plusieurs reprises, de ce suicide inévitablement réussi en 1963. Cette « inévitabilité » se remarque aussi dans le durcissement progressif, comme des pierres fendues, des dernières poésies : comme si Plath elle-même était consciente de refermer son problème d’excès de vie, transvasée et distillée jusqu’à son essence finale. Son expérience de jeunesse de la psychiatrie et des électrochocs en 1953 l’avait épouvantée même sans l’abîmer (nous voulons l’espérer) physiologiquement. À Londres, en 1963, auraient suffi un environnement encourageant et authentique, plus d’argent, « la volonté », pour substituer à l’ancien et archaïque hôpital psychiatrique un psychologue. N’oublions pas du reste que fondamentalement (probablement) il reste chez Plath le problème non éclairci du père, perdu quand elle avait neuf ans, et jamais retrouvé sous forme « substitutive ». Et donc, ce problème de fond a été mal ou jamais résolu psychologiquement, vu que le traumatisme infantile et puis adolescent (les hôpitaux psychiatriques, les électrochocs) est un double traumatisme non résoluble à travers le « confessionnalisme » de ces peu nombreux mais âpres poèmes rédempteurs, qui en fait sont d’une basse qualité et les « traces » du traumatisme à affronter. Problème qui est ensuite encore moins résoluble à travers un roman à finalités commerciales. Ainsi, à partir des lettres et de la biographie d’une poétesse d’un talent aussi inhabituel, il n’y a peut-être qu’une seule interprétation à garder : si en accusant symboliquement « la mère » on accuse à travers elle une société thérapeutiquement ignorante et mécanique, et, ce qui est pire, inconsciente dans son matriarcat d’empreinte capitaliste1, alors d’accord : mais on doit le faire aussi pour l’Italie et l’Angleterre, où certainement on espérerait que dans les années quatre-vingt dix l’influence de l’environnement puisse sauver à temps, puisse sauver aussi du suicide et de l’attention de critiques publicitaires (s’il faut toucher finalement le lien spécifique).
Mais pour changer de thème et illustrer quelques-unes des plus belles poésies de la Plath, que j’ai mentionnées plus haut, je voudrais en présenter ici cinq déjà publiées dans le volume Les muses inquiétantes de Mondadori, auxquelles je joins cinq autres traductions inédites de poésies extraites du volume encore peu connu des Collected poems édité par Ted Hugues pour Faber & Faber (1981). Ce livre très intéressant comprend tous les poèmes de la Plath, y compris ceux écrits entre 1956 et 1963. Le volume, de 340 pages, inclut dans la section Juvenilia, cinquante poèmes parmi ceux que la Plath écrivit durant les trois ou quatre années avant 1956. Beaucoup d’entre eux ont été composés en tant que devoirs imposés par son professeur d’anglais au Smith College, Alfred Young Fisher : dans presque tous les cas, Sylvia semble avoir accepté les suggestions textuelles du professeur. Dans le livre, enfin, il y a une référence aux Uncollected Juvenilia, environ quatre-vingt dix poèmes de jeunesse inédits conservés aux Archives Sylvia Plath et dans la Lilly Library de l’Université de l’Indiana ; d’autres encore, mais dont l’éditeur Hughes fournit seulement les titres, se trouvent au Sylvia Plath Estate, et sont tous antérieurs à 1956, donc avant ses vingt-quatre ans.
La grande nouveauté de Collected Poems, introduit par Ted Hugues, est que tous les poèmes sont enfin présentés dans l’ordre chronologique, autant que possible (puisque tous les poèmes ne portent pas de date).
Le premier livre de la Plath est pourtant de 1960, et a été publié par l’éditeur londonien W. Heinemann le 11 février 1963. À l’époque de Noël 1962, la poétesse recueillit la majeure partie de ses poèmes, aujourd’hui connus comme le recueil Ariel en une séquence soigneusement étudiée. Il rassemble environ deux ans et demi de travail, achevé juste avant sa mort, survenue le 11 février 1963.
Ariel, qui fut ensuite publié à titre posthume en 1965 par Faber & Faber, était un volume plutôt différent de celui que la Plath avait continué d’écrire en 1963, bien qu’elle-même le considérait comme une partie d’un éventuel troisième livre, et d’inspiration différente de ceux écrits entre Le colosse de 1960 et ceux de 1960-62. Hughes considère l’anthologie édité par ses soins comme un compromis entre la publication d’un grand volume de la production poétique entière de Sylvia et les œuvres seules, sorties entre 1965 (Ariel), 1967 (The Colossus, réimprimé intégralement par Faber & Faber) et 1971 (Crossing the Water et Winter Trees).
Les cinq poèmes inédits que j’ai traduits et présentés ici sont tirés de Collected Poems de 1981, qui sera publié dans quelques années par Mondadori.
1« matriarcato di stampo capitalistico ».