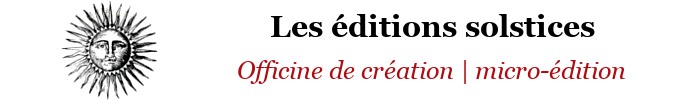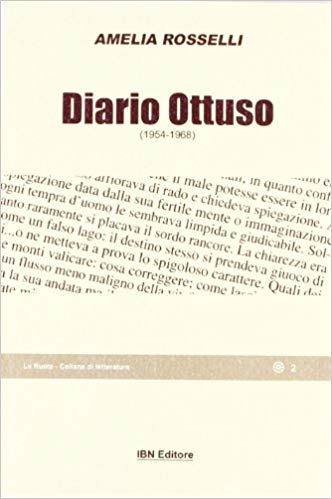C’est sans doute un des recueils les plus touchants d’Amelia Rosselli. Ses différentes parties ont paru séparément jusqu’à la publication en volume, en 1990, Il est constitué de :
~ Prime Prose Italiane (1954) ;
~ Nota (1967-1968) ;
~ Diario Ottuso (1968) ;
~ Esperimenti Narrativi.
Ce dernier texte vient éclairer non seulement la lecture de ce recueil, mais marque une étape importante dans le parcours poétique de Rosselli.
Pour « Dario Ottuso (1968) » et pour « Esperimenti Narrativi », nous n’avons pas joint le texte original en italien. Cela aurait considérablement alourdi une publication déjà, nous en avons conscience, difficile à manier à cause du support choisi.
Nous espérons néanmoins qu’on trouvera le temps, la patiente et l’énergie de lire ces textes qui sont, encore une fois, parmi les plus lyriques de la poétesse.
La publication d’une plaquette bilingue serait la bienvenue.
Le volume étant très court, j’ai dû me restreindre pour ne pas dépasser ce qui est toléré en termes de reproduction sans droits. Avec celles et ceux qui voudraient en savoir plus, je serais ravi de partager les traductions entières.
***
Prime prose italiane
*
Non so quale nuovo rigore m’abbia portato a voi, case del terreno nero. La stesura dei campi vi spinge sul limite dei viali appena inalberati. Tra i cespugli torti le case s’innalzano violente. Rompe il numero un fuoco d’erbe accese.
Ha le dita prese dal fastidio la luna, piena la notte, incomoda giù per i balconi nuovi. È tremante il quartiere d’ingiuria. La collina sciupa il nodo del sole.
*
Il ponte è perfettamente bianco e si stende perfetto sul fiume appena mosso. Le costruzioni pallide si rincorrono fino alla sponda. In là varca un ponte grigio.
Oltre lo squarcio della strada non andare, se questo è l’ultimo paesaggio.
*
Che strana trattoria possibile che anche qui sanno tutto ? Mi accoglie l’oste grasso pericoloso con occhio sapiente. Era molto tempo sapeva. Mia esistenza dove m’hai buttata !
*
Bellissimo cameriere tu sei il re d’Italia tu che pazientisci e corri per le camomille.
*
Roma città eterna che silenziosamente di notte ti bevi il tuo splendore hai tu nulla da predire. Ti sei fatta principessa e languisci. Nulla ti vieta. Arrotonda pure i tuoi seni bianchi e lustri. Le massaie si sono stancate di portarti le acque piovane. Tu hai succhiato latte di volpe hai rubato hai saccheggiato e ora siedi riposi assestata.
*
L’acqua è una grande rana.
Il fiume si scioglie di carità. La carità scioglie i vizi l’acqua fiumara scioglie la città dondolante di incuria.
L’albero piange sottile armonioso di doglie.
Il fiume se ne va lentigginoso per via della brezza che non lo lascia più. È una pantera questo fiume brigante. Non chiede nessuna compagnia.
L’ombra dei tronchi duri piedistalli.
Ombre che vi rammaricate ombre fate scherno. Indicate che ho perduto le stagioni.
Lisciati acqua per l’arrivo del mare pettinati e sorvegliati grossolana.
Morti voi camminate lungo le rive a sfiorare le donne.
Mare, ti hanno proclamato. Sei una grande bestia lumaca. Hai la sordità nel fondo tufo. Mare mare hai la gioia e la misericordia con te. Sei un fiore trasparente una forte tomba.
*
Tu pioggia amica leggera tu cammini dolente tu cammini dolente e lenta e scendi i tetti per soccorrere.
Le acque scorrono con appena un suono.
*
Barocco bello tutt’impigliato bianca ginestra con la solita Maria blu sul liquido cero nudo scandalosamente il Cristo attraente alle bambine. Cristo Jesù legno che non marcisi con lo cuore spinoso.
*
Erba nera che cresci segno nero tu vivi.
*
Il fiume delicatamente si torce. Bello che sei fiumicino cadaverino. Ti pescano. Siedi come un cane.
***
Premières proses italiennes
*
Je ne sais quelle nouvelle rigueur m’a porté à vous, maisons au terrain noir. La texture des champs vous pousse à la limite des voies à peine désarborées. Entre les arbustes tordus les maisons se dressent violemment. Le numéro est rompu par un feu d’herbes incendiées.
Elle a les doigt prise par l’ennui la lune, pleine la nuit, incommodée en bas par les nouveaux balcons. Il est effrayant ce quartier d’injure. La colline défait le nœud du soleil.
*
Le pont est parfaitement blanc et s’étend parfait sur le fleuve bougeant à peine. Les constructions pâles se poursuivent jusqu’à la berge. De là traverse un pont gris.
Ne pas aller au-delà de la déchirure de la route, si c’est l’ultime passage.
*
Quelle étrange cuisine possible si ici aussi ils savent tout ? Je suis accueillie par l’hôte gras dangereux avec l’œil qui sait. Il avait longtemps il savait. Mon existence où tu m’as battue !
*
Très beau serveur tu es le roi d’Italie toi qui patientes et cours pour les camomilles.
*
Rome ville éternelle qui silencieusement de nuit te bois ta splendeur tu n’as rien à prédire. Tu t’es faite princesse et tu languis. Rien ne t’interdit. Arrondis si tu veux tes seins blancs et lustrés. Les ménagères se sont lassées de te porter les eaux pluviales. Tu as sucé le lait de louve tu as volé tu as saccagé et maintenant tu t’assois reposes stabilisée.
*
L’eau est une grande grenouille.
Le fleuve se dissout de charité. La charité dissout les vices l’eau fluvière dissout la ville balançant d’incurie.
L’arbre pleure fin harmonieux de douleur.
Le fleuve s’en va avec ses tâches de rousseur par voie de la brise qui ne le laisse plus. C’est une panthère ce fleuve briguant. Il ne demande aucune compagnie.
L’ombre des troncs durs piédestaux.
Ombres qui vous ramifiez ombres faites raillerie. Montrez que j’ai perdu les saisons.
Aplatis ton eau pour l’arrivée de la mer coiffe-toi et surveille ta grossièreté.
Morts vous marchez le long des rives à effleurer les femmes.
Mer, on t’a proclamée. Tu es une grande bête d’escargot. Tu as la surdité dans le fond bond. Mer mer tu la joie et la miséricorde avec toi. Tu es une fleur transparente une forte tombe.
*
Toi pluie amie légère tu marches endolorie toi tu marches endolorie et lente et tu descends les toits pour secourir.
Les eaux s’écoulent avec à peine un bruit.
*
Baroque beau tout compliqué blanc genêt avec l’habituelle Marie bleue sur le liquide cierge nu scandaleusement le Christ attirant pour les petites filles. Jésus Christ de bois qui n’y pourris pas avec le cœur épineux.
*
Herbe noir tu crois signe noir tu vis.
*
Le fleuve délicatement se tord. C’est bien que tu sois petit fleuve petit cadavre. On te pêche. Tu es assis comme un chien.
***
Journal obtus (1968)
Pourquoi ne pas comprendre la vie toute seule ? Pourquoi ne pas forcer la vie à se comprendre ? Pourquoi ne réussit-elle pas à comprendre la vie ? Et en fait elle ne comprit pas la vie, sinon elle n’aurait pas eu peur de la vie, au lieu de la défier, comme si elle avait été un puits à remplir. La vie est un puits vide et on doit respecter son vide.
Et puis elle fit bien de partir, et elle fit bien de s’épargner, et elle fit bien aussi de laisser tomber la vie ; et elle fait bien encore de ne pas se laisser tenter par la vie.
Elle laissa la vie épargner ses forces, comme si ces champs qui n’avaient rien donné n’étaient pas déjà morts. Elle, elle fuit, elle fuit, elle s’épargna et (erreur) elle ne se laissa pas vivre. Elle se laissa tomber dans le puits maléfique ; le fond était une lumière égale, c’était pointu de se demander où c’était mais pourquoi je suis si belle : elle répondit en se regardant bouger entre les seaux rouillés. Le pourquoi est-il de la solitude ? ou le pourquoi est parce que la solitude est le pourquoi, est meilleure, plus vivace, moins pénible ? Elle s’étendit au fond du puits et elle se dit qu’elle aimait la terre, parce que la terre ne pouvait pas être autre chose que le puits, rond, le creux dans le nombril de la terre : et la terre, son monde vert et tordu n’était pas propre.
Mais le propre est frais de crasse que j’ai fait pousser sur mes pieds comme si c’étaient des plateaux, dit-elle, en se prenant pour un autre. Je n’ai pas de problème, je suis maintenant aussi sage que les autres, je suis maintenant ronde comme le cercle et la tente plantée malgré le désert éloquent de lubrifiants. Je suis maintenant ronde et je ne veux pas vous voir croire que je suis moins ronde que vous !
Mais tout office a son État et la mise en scène était telle qu’ils croyaient qu’elle pouvait être fausse, disjointe du verdict, qu’elle avait construit seule dans son microscopique cerveau. Je n’ai pas d’argile pour mes pensées c’est donc mieux que je ne cultive pas mes pensées, pensa-t-elle en retirant son pantalon qui désormais la …
Désormais je n’ai plus de main à baiser, se dit-elle, et il y avait des milliers qui lui baisaient les doigts entaillés par le couteau du pain. Désormais je montrerai que j’ai grandi jusqu’à cet âge que vous aviez quand vous m’avez mise au monde !
Il n’y a pas de monde prêt pour moi et ainsi je pars pour un monde moins prêt pour moi qui voudra me faire souffrir sévèrement pour les peines que je me souviens pas d’avoir souffert, et pour mon arrogance : moi j’ai toujours cette vieille faute de ne pas avoir su être personne…
Et avec un esprit fin elle se tailla les deux mains.
Désormais je ne voudrai plus être personne, pensa-t-elle – et elle adopta un nouveau comportement qui put lui permettre d’être ce qu’elle désirait être, c’est-à-dire personne. Mais à chaque baiser à la main furtive elle suivait un regard à la main baisée, qui l’étouffait de remords et la chassait de chez elle, comme si en fait il ne restait rien d’autre que de partir de chez elle. Je n’ai plus quarante ans, riait-elle en pleurant, et elle donna sa démission. Désormais je n’ai plus personne se surprenait-elle à dire, et elle n’avait même pas fini de dire ce qu’elle disait quand la cloche sonna.
C’était la cloche de midi qui torturait les jésuites, qui comme elles se croyaient obéissants envers Dieu. C’était une cloche qui sonnait pour les quelques-uns qui contemplaient encore Dieu. Mais à elle il ne restait rien d’autre que rester, d’abord, pour pouvoir contempler Dieu, et partir, ensuite, pour renier Dieu.
VII
(…)
Plutôt le mal, la vérité brusque et tragique et la décision qui en résulte, que cette danse continue entre joie extatique et très brève, et difficulté à dominer la douleur souterraine et inexplicable. Pire, le mal des autres parfois resplendissait très net, et les causes étaient claires : mais tous les deux au fond de son âme étaient pardonnables puisqu’ils n’étaient pas intentionnels, puisqu’ils étaient confus, désespérés. Le soupçon que le mal pouvait être en eux clair et décidé affleurait de temps en temps et réclamait une explication. À l’explication donnée par son esprit fertile ou son imagination chaque trempe d’homme lui semblait limpide et jugeable. Seulement à de rares occasions s’apaisait la sourde rancœur. La clarté était comme un faux lac : le destin lui-même se moquait d’elle… ou mettait à l’épreuve le caractère anguleux. Lequel des deux monts franchir : que corriger ; comment se laisser aller à un flux moins mauvais de la vie ? Aucun pont ne faisait obstacle à sa route mais son retour était déchiqueté par les mines déterrées, et de nombreux petits ponts grisâtres s’effondraient dans les roches bidextres, maladroites, asséchées, lugubres.
Comment se mettre d’accord sur le gâchis ? Comment résoudre sa propre ambiguïté ? La fuite devenait burlesque et ce rêve pathétique d’un avenir calme et droit n’était qu’un jouet entre ses mains.
Désormais la fugue se transformait en un déchirant désordre végétal et animal. Les fosses se remplissaient de lentes larmes rouillées, et, elle, elle descendait dans ces petites vallées sales pour tenter une sortie de la collection de déchets accumulés là-bas, ou dispersés de manière immonde dans les plaies salles de la fosse. Elle errait, embarrassée, avec les pieds enfoncés dans la boue besogneuse de ses chaussures trempées.
Et ainsi il y eut une lumière exacte : elle se convainquit d’avoir trouvé sa dimension vitale : ne pas savoir, ne pas voir, ne pas comprendre.
Expériences narratives
Comparer différentes proses courtes, de différentes époques – alors qu’au contraire l’attention était portée surtout sur l’écriture de poèmes – a été l’intention de ce livre.
« Premières proses italiennes » est un texte court de 1954, et a un titre un tantinet ironique. Mais il s’agissait vraiment de la première fois que j’écrivais en italien, en prose non scientifique ou simplement non fictionnelle et rationnelle. Et il y avait aussi l’intention d’éviter la prose poétique, et l’influence, entre autres, de Dino Campana était forte. Le texte est bref, en quelque sorte inspiré : et il a été inspiré, justement, par le Tibre, près duquel je vivais. En partie il a été écrit hors de chez moi, en marchant, et donc écrit à la main ; ou alors c’étaient des notes que je prenais mentalement et ensuite je retranscrivais cette écriture mentale, une fois chez moi. Je crois pourtant d’être parvenue, il y a très longtemps en 1954, à éviter (comme la peste), la typique écriture dite « prose poétique », si commune à l’époque. Ce texte voudrait avoir la tendreté de la poésie de Scipione, et ainsi éviter le dramatique Campana.
Naturellement il s’agit d’une réimpression, le texte est extrait du livre Premiers écrits (1952-1963) publié chez Guanda en 1980.
Pour « Note », publié à la fin des années soixante-dix dans le revue « Autobus » n.0/1, dirigée par Giorgio Manacorda, les dates et les intentions sont moins simples. Ce sont des textes écrits à moitié à la main, et l’autre à la machine, et avec une intention peu claire : on le voit aux dates (1/1/67 ; 25/3/67 ; 12/1/68 ; 30/12/68). En obtenant cependant – à travers cette pratique de la prose, en écrivant dans le train, ou assise dans un café esseulé, ou au contraire devant la machine à écrire – une unité involontaire. En fait quelques passages, d’environ une page et demi presque tous les cinq (et cela par hasard), étaient autre chose qu’une pratique de l’écriture, notes retranscrites dans des lieux différents et à des époques parfois lointaines. C’est une prose difficile, intérieure autant que la poésie, mais qui voudrait refléter comme un miroir incurvé, le rationnel. Je l’ai lue en public une fois, au lieu de lire des poèmes et l’attention était peut-être plus importante. Les cinq passages furent ensuite choisis par Spagnoletti, comme prose errante dans le livre qu’il a édité, Antologia Poetica (Garzanti 1987).
Dans un sombre automne-hiver de la pensée, j’écrivis Journal obtus, qui est de 1968, et que j’aurais voulu être le début d’une autobiographie possiblement très peu biographique. Je tentai un style brut et simple, plus tard appelé « sauvage ». Le premier chapitre devient ensuite une espèce de mini-roman, parce que la conclusion était plutôt sur un ton philosophique, et qu’elle me paraissait douloureusement suffisante. Ayant évité l’autobiographie, autant qu’il était possible alors en poésie, ce texte « pauvre » en revanche l’admettait, avec quelques coupures, pour ne pas laisser reconnaissable d’idéals « maîtres », d’idéal « frère », et d’« ambiance culturelle » romaine. Pour le reste le titre et le texte parlent d’une adolescence difficile et tardive ; d’où le style un peu ridicule, et les conclusions négatives.
Journal obtus je le gardais jusqu’à sa publication sur la jolie et petite revue romaine « Braci » n.7 (1980), comme mon seul texte intime et que je n’ai pas encore tout à fait compris.
Des trois textes est évident que ce qui m’attirait était l’expérimentation en prose : il est également vrai et probable qu’on dit davantage en prose qu’en poésie, souvent maniériste et décorative.