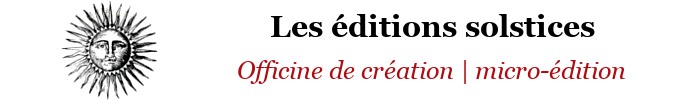Il est deux heures du matin, je suis couchée dans mon lit. Le sommeil a disparu ; de multiples souvenirs de mon enfance refont surface. Mon homme ne dort pas non plus ; il se tourne et se retourne. Cela fait plusieurs jours que je pense et repense à mon beau village et à l’ambiance qui m’attend là-bas. Du moins j’imagine. Je me suis longuement préparée moralement à abandonner mes enfants avec leur père, le temps d’une quinzaine. C’est la première fois que je serai loin, très loin d’eux et pendant une aussi longue période. Vais-je tenir ? Vont-ils tenir tout ce temps sans maman ? Autant de questions que je me suis posée. Mais c’est décidé et je dois partir. J’ai tout préparé et je prierai tous les jours afin que le bon Dieu veille sur eux et surtout sur moi. Oui, surtout sur moi. Je repars enfin dans mon pays, ma terre natale, mon origine. Dix ans que j’ai passé à l’étranger, et pas une seule fois que je suis retournée à Baham. Je pense aussi à Lille, cette ville qui m’a accueillie et où je me suis construite, où j’ai tout construit.
Je me lève doucement et sans faire de bruit, je sors de la chambre. Les enfants dorment profondément. Je vérifie que chacun a bien ses affaires de sport et son goûter pour l’école. Je le fais habituellement, mais pas à cette heure-ci. Mon mari me rejoint dans la cuisine où je me suis assise et me ramène dans la chambre à coucher. Il me fait un câlin et me demande de me rendormir. C’est ainsi que blottie contre lui je finis par retrouver le sommeil.
Drin, drin, drin ! le réveil sonne. Il est 6 h du matin et il faut se préparer à partir. Je monte dans la voiture côté passager à l’avant, et mon mari prend la place du conducteur. Direction Bruxelles, une heure de route pour rejoindre l’aéroport international. Le temps passe vite. Nous y sommes. Je fais enregistrer mes bagages remplis de cadeaux de toutes sortes. Une dame qui a un excédent de kilos me propose de récupérer quelques bricoles ; je n’hésite pas une seconde et les mets dans mon sac-cabine. Ça fera certainement des heureux là-bas.
Le check-in terminé, je dis rapidement au revoir à mon mari, et je fonce, de peur de craquer. Je passe les contrôles de sécurité et me voilà assise sur le siège numéro 43, à bord du boeing 237 en direction de Douala. À cette période creuse de l’année, le vol est tout de même plein. Je suis installée à côté d’un jeune chinois qui fait le voyage avec sa fillette métissée d’une dizaine d’années environ. On parle brièvement et j’apprends qu’il rentre de vacances et rejoint Yaoundé où il vit avec sa famille. C’est nouveau, un asiatique qui épouse une noire et s’installe en Afrique.
Le commandant de bord fait une annonce et nous demande d’attacher nos ceintures. L’avion est prêt à partir. Prêt à partir. C’est par ce moyen que mon mari est entré sur le territoire européen. Le vol se déroule normalement et après une escale à Kingshasa, l’avion se pose sur la piste de l’unique aéroport international du Cameroun.
Il est huit heures du soir. En ce mois de février, je ressens à la sortie de l’avion un air tout chaud qui me rappelle celui de mon chauffage que j’ai laissé allumé en partant de Lille. Un agent des douanes au visage sympathique se rapproche de moi et me propose son aide afin de me passer sans encombre les services de contrôle-bagages, ceci contre une somme de cinq mille francs (l’équivalent de sept euros). Je trouve sa démarche aberrante. J’ai l’impression de vivre une triste scène de la mafia… Je ne joue pas son jeu. Avec le sourire, je décline sa proposition en le remerciant ; je me plie aux formalités comme la plupart des gens. À quoi bon encourager ce genre de pratiques ? et de toutes façons, je ne transporte rien d’illégal ou de compromettant.
Une fois sortie du hall de l’aéroport, je vois une série de voitures toutes peintes de jaune ; ce sont les taxis de chez moi. Des hommes se tiennent à côté, chacun criant le nom de diverses destinations, ceci dans un vacarme formidable. Je reconnais un peu plus loin mon cousin Mbangue venu me chercher avec sa veille Toyota Corolla qu’il avait déjà quand j’étais petite. Il m’emmène alors à la maison familiale où tout le monde m’attend. Sur le trajet, il s’est arrêté pour prendre des passagers ; il m’explique que c’est pour récupérer un peu de sous. Il le fait régulièrement pour compléter ses maigres revenus.
À mon arrivée, je suis acclamée comme une star de la télévision. La famille m’a réservée un accueil formidable : la joie, les chants, les pleurs pour certains. J’ai à peine le temps de poser mes valises que déjà il faut passer à table. Celle-ci est pleine de mes plats préférés. Les odeurs des épices ! J’ai très faim et je ne me prive pas. Je revis la belle fraternité africaine qui j’espère perdurera jusqu’à la fin des temps.
Pendant le repas, je réponds aux multiples questions posées par les uns et les autres. Ils me réclament des photos. Ma sœur s’amuse à manipuler mon téléphone. Quand vient le moment de me doucher, mon neveu Kamdem, âgé de dix ans à peine, va chercher un sceau rempli qu’il dépose à l’arrière de la maison. Il n’y a pas beaucoup d’évolution de ce côté. J’entre alors dans une sorte de cabine, un espace emménagé avec un banc en bois pour déposer ses effets de toilette. Elle est entourée de bambous et de quelques feuilles de paille. Je m’éclaire à la lampe tempête. J’ai un peu peur de me laver dans ces conditions ; j’ai pourtant connu cela. Ma sœur reste à proximité. J’ai laissé ma luxueuse salle de bain à Lille. N’ayant pas de choix et respirant fortement, je me décide à retirer mes vêtements que j’accroche sur le mur de paille. Je pose également ma trousse de toilette sur le banc prévu à cet effet. Une pluie soudaine se met à tomber et je prends une double douche. Comme disait ma grand-mère, la pluie c’est la bénédiction.
Pour le coucher je partage le lit avec ma sœur et sa fille de trois ans. Malgré la fatigue, j’ai du mal à trouver le sommeil. Ma sœur me tient compagnie en me racontant toutes les petites histoires de la famille. On finit par s’endormir toutes les trois. Cette première nuit est l’une des plus belles que j’ai passée.
Le matin arrivé, c’est l’occasion pour moi d’accompagner ma tante au marché. Ici le marché a lieu tous les jours. Sur le chemin, je reconnais une amie d’enfance et des personnes un peu familières qui à tour de rôle me serrent dans leurs bras. Une fois au marché Nkolbisson, je revois le théâtre auquel se livrent les « buy and sell am », ces femmes dévouées qui vendent toutes sortes de vivres. Elles interpellent leurs clients réguliers ou potentiels : « Asso, asso ! » et il faut comprendre : « mon associé ». Ma tante et moi, nous prenons le temps de remplir notre sac, accompagnées par un porteur qui recevra à la fin cent francs (soit environ quinze centimes d’euros). Le marché est certes coloré par la diversité des produits qu’on y trouve, mais c’est tellement bruyant que je suis bien contente de rentrer.
Trois jours se sont écoulés depuis mon arrivée. Prochaine étape de mon voyage, le village. C’est là où je suis née. La terre de mon père et de mes paires, c’est le lieu où je suis en communion parfaite avec tout et tout le monde.
Je choisis l’une des meilleures compagnies pour effectuer ce déplacement. De plus, je peux me payer le luxe d’acheter un ticket VIP. Hé oui ! Ma vie a changé et je ne me prive pas de m’offrir ce qui me faisait tant rêver autrefois…
Le chauffeur du bus, après avoir mis en sécurité la bouteille de bière qu’il tenait à la main, s’installe à son aise au volant et nous partons. La route est très mauvaise ; pleine de cassis. Je n’ai pas fait le tour de la France, mais je suis certaine que même dans les contrées les plus reculées, il n’existe pas ce semblant de route. Rien n’a changé ; le bus est plein à craquer. C’est la période des vacances scolaires et plusieurs femmes se déplacent avec leurs enfants. Mais elles n’ont pas les moyens de payer des places assises pour les petits et ils font le voyage assis sur les genoux de leurs mamans.
Soudain dans le bus, un homme se lève et prend la parole. Il prend la peine de saluer son auditoire avant de présenter les médicaments traditionnels qu’il commercialise : contre le paludisme, les diarrhées, la fièvre typhoïde, l’infertilité chez les femmes, les troubles de l’érection… la liste est interminable ! De miraculeuses poudres et des potions qui soignent tout. Et si seulement c’était possible, on ne compterait pas autant de décès, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Il réussit tout de même à se faire quelques billets. Un peu plus tard, c’est au tour d’une jeune dame de proposer des plats cuisinés, conditionnés dans des feuilles de bananier : poisson grillé et bâton de manioc, légumes sautés accompagnés d’igname, etc. Les moins affamés se contenteront de brochettes d’huîtres ou simplement de cacahuètes. Nous sommes bien loin du modèle européen, où on se sent tellement gêné de devoir déranger les autres passagers avec des odeurs fortes de nourriture. Encore deux cents kilomètres à parcourir dans cette ambiance de folie, où les uns et les autres se régalent, proposant des fois à ceux qui n’ont pas pu s’offrir quelque chose de partager avec eux. Les autres racontent des anecdotes, toujours dans l’objectif de faire rire aux éclats le plus grand nombre. Je me laissais aller à admirer le beau paysage du littoral, les chutes époustouflantes de la Lobé, Le fleuve Wouri, le pont sur la Sanaga… Je n’avais pas revu tout cela depuis mon départ de Babimbi. En traversant les plaines côtières, je revois les statuts de Martin Paul Samba et Douala Manga Bell, ces valeureux combattants qui avaient lutté pour la libération du pays.
Toutes les heures, le conducteur est contraint de s’arrêter à la demande d’un passager. Ce n’est pas pour pouvoir s’acheter un kebab ou une pizza, mais pour que certains passants, pressés par leurs besoins, puissent s’éloigner un peu dans la forêt ou la broussaille afin de se soulager. Je n’ai pas le courage de me joindre à ce manège et je serre les fesses, malgré les cassis sur la route. Il est tout simplement devenu impossible pour moi de me comporter de la sorte. Moi, une habitante de Lille, habituée aux toilettes modernes…
À l’arrivée, ma tante, Sita Henriette m’attendait. Elle m‘accueille chaleureusement, avec un cri de guerre qui traduit sa grande joie de revoir sa tendre nièce, après tant d’années.
Toutes deux remorquées sur une bicyclette, communément appelée Ben Skin, nous arrivons à la maison familiale. Je suis décontenancée par un changement frappant : la cabane que j’avais laissée est devenue une maison en dur, la terre battue a disparu, laissant place aux parpaings. C’est un choc ! Impatiente et inquiète de découvrir la suite, j’entre précipitamment dans la maison. L’agréable parfum ancestral de mes souvenirs s’est évaporé, je ne vois plus le feu de bois au centre de la maison comme au bon vieux temps. Je balaye alors du regard l’ensemble de la pièce et je constate également que le lit de grand-mère, celle qui m’avait bercé dès mon premier jour, a été retiré. J’ai le cœur pincé. J’ose à peine demander à ma tante ce qu’elle a fait du couchage mon aïeule. Elle m’explique qu’après son décès, il y a quatre ans déjà, elle a tout débarrassé, et tout fait détruire. Le mobilier sommaire de la case lui rappelait incessamment les souffrances et la maladie qui avaient emporté sa mère. La douleur d’entendre ce qu’a enduré mon adorée me met les larmes aux yeux. Je n’ai pas la force de me retenir. Et pourquoi me retenir face à l’émotion ressentie dans un contexte pareil ? Sita Henriette me conduit alors où elle a été enterrée. Je dépose sur sa tombe en terre la gerbe de fleurs que j’avais achetée exprès à Paris et que j’ai précieusement conservé. Je reste quelques temps assise par terre auprès d’elle, comme si je veux la sentir ou me rapprocher le plus possible. Avant de revenir vers la maison, j’implore le bon Dieu de veiller sur elle en disant une prière : elle avait fait de même en me donnant sa bénédiction lorsque je partis pour l’Europe.
Grâce au soutien moral et à la bonne humeur de ceux qui sont venus m’entourer, je mets au frais ce triste et douloureux épisode. Peu de temps après, le reste de la famille et certains habitants au retour des champs arrivent avec leurs enfants. Ils sont tous là, espérant chacun repartir avec un petit cadeau. Je distribue ainsi bonbons, biscuits, chocolats, au grand bonheur de tous. Un petit fait la remarque que les bonbons des blancs sont plus sucrés. J’esquisse un large sourire en lui disant qu’il avait bien raison. De jeunes adultes sont également venus au rendez-vous de la découverte. Le mythe de l’Europe, l’Eldorado, est encore suavement gravé en eux. Certains sont même surpris de me voir avec le même teint d’ébène : on leur avait annoncé que « la blanche » était arrivée. Je ris aux éclats ! Ils avaient appris que lorsqu’un noir allait chez les blancs, il devenait blanc. Ils n’avaient pas compris que l’occident entraînait inévitablement un métamorphisme culturel, mental et psychologique, mais nullement au niveau de la peau.
La nuit tombée, ma tante, aidée de mes petits neveux, allume un grand feu dans la cour. Le feu est attisé, afin qu’il se maintienne, à tour de rôle par des volontaires. Tous ensemble, nous avons fait de la grillade de maïs, des safous et d’autres mets à partir de ce qui est récolté dans les champs. Je suis comblée de cet infini amour dont me couvrent les miens. Toutes les femmes de la concession sortent chacune à leur tour avec des plats cuisinés en mon honneur. C’est un moment de partage magique. Grand-père, en compagnie des oncles, me raconte des histoires du village. Ces scènes me plongent dans le monde ancestral et culturel. Des histoires parfois invraisemblables, pourtant réelles, de sorcellerie. Puis je m’évade quelques temps en pensant à celle qui aurait dû m’attendre… Elle me manque terriblement dans ces moments. Les autres sont certes là, mais comme dit Lamartine, « un seul être vous manque et tout est dépeuplé ».
Vers minuit, épuisée mais heureuse, je vais me reposer dans la chambre qui m’a été réservé. Dans mon sommeil, j’entends une voix qui dit : « Ma fille, ma fille chérie, tout ce que tu demanderas te sera donné ». Au réveil, je me rends compte que c’est la voix de grand-mère, ma mère protectrice.
Mon cousin Ntsimi est venu me chercher de bonne heure pour aller à la chasse « aux rongeurs ». En effet, plusieurs animaux de cette classe sont très appréciés pour leur chair. On prévoit de ramener pour le repas des hérissons, des porcs-épics, des rats, etc. Ayant perdu l’habitude de ce genre d’activités que tous les jeunes pratiquent, je me contentais simplement d’observer, et ceci avec beaucoup de passion. Les pièges tendus la veille ont fait leur travail et nous rentrons au village la hotte chargée de gibier. La chasse avait été fructueuse.
Il est maintenant temps de retourner en ville. L’émotion est intense. Je vis une sorte de sentiment d’anxiété, car je dois de nouveau abandonner cette terre de paix. Ce sont des moments de joie intense. Toutefois, en regardant autour de moi, je suis frappée par la consternation à la vue des séquelles laissées par l’épineuse gangrène « ambazoniènne » qui mine ce pays depuis plusieurs mois. Que faire pour s’en débarrasser définitivement ?
Quatre heures plus tard, je me retrouve en ville où m’attend de nouveau toute la famille. Plus que quelques jours encore avant de repartir pour l’Europe. Étrangement, je ne pense pas beaucoup à mes enfants qui doivent sûrement me réclamer.
Le soir je reçois la visite de mes amies qui me proposent gentiment pour me faire des tresses. La tête coiffée de rastas, j’enfile un jean et un tee-shirt moulant pour sortir avec elles. Oui, c’était jeudi : « jeudi des filles ». Nous nous retrouvons dans l’une des meilleures discothèques de la capitale, celle-là même où j’avais fêté ma dernière soirée, la soirée d’au revoir, des années auparavant. Bien que défraîchie, elle a gardé sa renommée et l’ambiance y est toujours aussi chaude. Ah ma jeunesse ! L’une de mes amies a ramené son copain et ce dernier n’arrête pas de me coller, sans gêne. Son attitude me met si mal à l’aise que je finis par prendre congé.
Le jour du retour est maintenant arrivé. J’offre un dîner spécial pour la famille, en compagnie de mes amies. J’ai également convié des connaissances et quelques voisins du quartier.
À vingt heures, alors qu’habituellement on regarde le journal sur notre vieil écran de télévision, j’entends le klaxon du taxi qui a été appelé. Un sentiment de nostalgie m’envahit. Mais je dois partir.
Deux enfants sont appelés pour porter mes valises et les déposent dans le coffre du véhicule. Je leur tends une belle pièce chacun, et ils m’enlacent très fortement. Ma sœur m’accompagne jusque l’aéroport. Un vive émotion nous secoue encore au moment de la séparation. Elle me dit espérer qu’on se revoie bientôt. Je lui ai promis qu’elle me rejoindrait rapidement. Dans l’avion, de l’escale à Adis Abeba jusqu’à Paris, je revis les moments inoubliables passés sur ma terre natale.
Arrivée chez moi, le quotidien de la vie européenne, bien loin du climat ambiant symbolisé par des fêtes, le sourire, la joie de vivre, le soleil du pays, reprend rapidement le dessus. J’ai tellement à raconter à mes enfants restés ici… Mais je rêve surtout de leur faire vivre tout cela, afin qu’ils construisent eux-mêmes leurs propres mémoires.
*