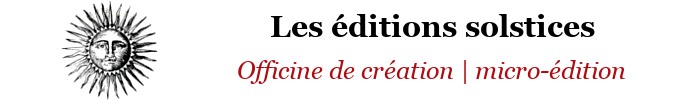Je vomis et je crache, et voici le col d’une montagne, les parois rocheuses, le chemin de martyre et de l’autre côté, une plaine et je vois un pays brumeux se lever.
●
premier jour
Après avoir marché avec peine et traversé ces sommets, et que de nombreuses heures sont maintenant passées, je traverse l’étroit col, le dernier, et devant moi s’étend alors un monde, une terre. Dans un souffle, je peux voir la mer à l’horizon et le petit pays s’étaler jusqu’à elle. Je regarde les ombres s’incliner. J’arrive en bas tandis que le soleil des hommes se couche, exténué. Le soir tombe. Sur le chemin qui descend, je vois un village dont les premières lueurs se réveillent et vacillent, posé sur les renforts de cette montagne, le noir se fait lentement, je me dépêche. Dans la première auberge, sur un lit je m’enroule dans les draps et les plis du soir.
●
second jour
Le matin perce ma fenêtre, le bruit léger de la rue se glisse dans la pièce avec le jour contre ma joue. J’ai salué l’homme qui m’avait loué une chambre pour la nuit et je suis sortie. Je marche dans les rues sans but, car mon voyage est sans but, sinon de voir le monde et ses changements. C’est une ville que je traverse et non ce que j’avais cru un village quand je l’apeçus dans le noir. Les bâtiments sont rangés, serrés, nombreux et hauts, et sur tous les murs se couche une suie noire épaisse. Des cheminées s’élancent partout et crèvent le ciel. À leurs bouches, crachés, des panaches noirs s’élèvent, féroces, précipités.
●
Une place entoure un arbre mort. Face à l’arbre est l’entrée d’une mine, un bâtiment carré pas bien haut, une porte et au-dessus comme une tour d’acier faite de quatre faisceaux puissants se joignant dans l’air, et puis des traverses, des câbles, des rouages dentés et du bruit et du mouvement. Devant l’entrée de la mine, des hommes s’agitent. Je m’approche, l’un d’eux est au sol, inconscient, deux autres s’apprêtent à le soulever, pour l’emmener, pour le soigner. Les hommes qui restent parlent entre eux et leurs voix sont fortes et pleines d’une pressante inquiétude. D’eux je m’approche encore et demande ce qui s’est passé. Les trois hommes me répondent que, dans le vieux filon, une Ombre s’est logée, que ces choses-là dorment très profondément sous le monde normalement, qu’il est étrange, qu’il est rare qu’elles remontent de la surface si proche, qu’ils comptent la chasser avec le feu. Ils m’expliquent qu’il faut un grand feu, de grandes flammes. Le premier des trois est un vieillard, une longue moustache blanche sans barbe, un képi verdâtre et des yeux brillants et sombres. Le second doit avoir le même âge, un ancien, le corps sec et noueux d’un olivier. Le troisième porte quarante années sûrement, ses cheveux ternes, sa chemise blanche. Des trois, son regard est le plus triste. Je les laisse et je m’en vais. Devant la porte de cette ville posée sur un renfort de la montagne, de ce point haut, je regarde la plaine, les vallons, les collines qui s’étendent et s’étirent jusqu’à la mer que je devine. Le soleil est à son midi. Je pars par la route qui descend au sud.
●
Longtemps je marche et souvent je m’arrête dans le creux des vallons pour prendre l’ombre et je la regarde s’étirer. La terre a la couleur de l’ocre, elle est une glaise rouge, et le sol est un maquis épais. Il n’y a aucune culture, pas d’arbre fruitier, je ne traverse pas de champ. Dans ce pays, ce n’est pas des blés qu’est tiré le pain. Les versants nord des vallons, des collines, ces versants toujours courus d’ombres clémentes ont les arbustes aux reflets bleus et les lavandes sauvages me caressent la peau quand je remonte les pentes ombreuses. Les versants sud regardent la mer et baignent dans la lumière du matin et dans celle du soir, ils ont leurs broussailles de clair, leurs épines m’entaillent joyeusement, et je dévale, je cours, et je ris. Et longtemps ainsi, heureuse.
●
Le soleil de ce pays est gros et lourd, il se traîne dans le ciel, rouge, turgide, ce gras soleil se charrie avec peine. Ce luminaire plein d’un orgueil ancien peut-être ne garde pas le souvenir de ceux qui, il y a longtemps, l’ont accroché sous la voûte, il y a longtemps, quand il fut mis au ciel pour vaincre la nuit. Souvenir égaré. Ce soleil ne se noie pas dans la mer où il se couche. Le soir tombe quand je vois enfin devant moi les hauts murs d’une ville immense. Dans les murailles arrogantes, douze portes percées, par elles, des foules humaines entrent et sortent.
●
Dans la ville d’Ocre je pénètre étrangère. La nuit qui tombe n’est pas une nuit. Dans les rues, des feux, des lanternes, des fanaux, des phares au-dessus de chaque bâtisse, brûlent et élèvent leurs fumées en défi à l’obscur. Partout brûle ce qui peut brûler, partout une lumière dorée coule épaissement sur les murs et les lueurs vacillantes dansent sans fin sur les pierres. Cette nuit jalouse du jour. Les ombres s’allongent noires mais elles sont rares, et cependant la grande ombre de la voûte demeure elle imperturbée et rien, ne vient la troubler, même les étoiles sont absentes de la bâche noire qu’elles ne percent pas. Cette ville, elle entière, réunie comme en un enfant qui a peur du noir, et je la comprends et je m’enivre de cet embrasement autant qu’il me perd. À la pénombre forclose, je me grise et ma tête tourne. J’erre dans les lueurs, sans ombre pour me suivre, et j’oublie la douleur de mes pieds.
●
La ville est grande et la nuit est maintenant avancée. Je suis devant la mer, sur une corniche assise et je contemple l’océan. J’ai erré longtemps, et puis j’ai vu la mer. J’ai marché à son côté, je l’ai écouté soupirer sa lente respiration. Je l’ai regardée, lourde, se former, son dos rond, venir s’écraser lentement sur la ville-promontoire qui entaille son ventre. Je respire l’odeur de l’abysse qui s’étend, aussi je voudrais me blottir et je sens la peur parfois comme une lame dans ma gorge. Les embruns volent en filet, et me blessent à leurs mailles. Je m’endors contre un mur qui, depuis toujours, regarde la mer.
●
troisième jour
J’ai rêvé un rêve étrange.
Il y avait une ville construite à moitié sur la terre et à moitié sur la mer. La Brume était partout, enveloppant chaque corps, chaque demeure, chaque foyer, chaque chose, et c’est à peine si je pouvais voir mes mains, cependant que bien d’autres choses je pus voir. Il y avait un port, un si grand que des hommes n’auraient pu le bâtir et les navires s’avançaient jusqu’au cœur de cette ville. Ces navires étaient des monstres de bois et d’acier, plus hauts que des tours, si grands, qu’un peuple devait les conduire. Et cette ville grise et noire habillée de brume portait un nom dont je ne peux me souvenir. Puis je vis la mer, j’étais au large. Et là non plus, jamais la brume ne se levait, et la mer était noire, lacérée d’écume. Une houle sans repos secouait notre navire qui labourait les eaux sombres. Il mordait la mer et la faisait saigner. La brume était si épaisse, je ne pouvais dire s’il s’agissait du jour ou s’il s’agissait de la nuit. Ni soleils ni étoiles n’étaient jamais visibles. Sur la mer noire, seuls perçaient la brume les halos rouge sang des bateaux-phares qui montraient les routes, et par eux seulement les navires ne s’égaraient pas en dehors des cercles du monde, et pouvaient espérer rentrer au port. Les hommes chassaient des monstres marins, qui étaient comme des montagnes au corps lisse et silencieux. Ils les tuaient et le sang coulait, je compris que c’était ce sang noir que nous cherchions si loin. Car si important était vraiment ce sang, qui alimentait de ce monde les feux brûlants.
Je tombais dans l’eau et j’étais avalée par un de ces monstres immenses qui habitaient cette mer, et alors je me réveillais.
●
Je me lève sous le grand jour, éblouie par le soleil. Le dos est douloureux de cette nuit. La mer est face à moi, maintenant je peux la voir aller jusqu’à l’horizon. Son souffle est le même, son rythme est pareil à cette nuit. La mer, du jour, ne semble pas affectée. C’est que la mer est plus vieille que le jour, elle est née bien des temps avant les trois soleils des Hommes. Je retourne à mon errance. Je traverse et contemple la splendeur des bâtiments et des hauts murs d’Ocre et je sais désormais la gloire de cette ville, l’éclat de ses monuments, la beauté de ses arches, le nombre de ses fontaines. Rapidement je me lasse de cette gloire.
●
Il y a un enfant face à moi, une jeune fille qui m’a vue ou qui me regarde. Elle est passée au bout de cette étroite ruelle qui descend, elle est passée en courant. Elle a soulevé une plaque d’acier puis a disparu. Elle avait les avant-bras noirs. Je soulève la plaque, un chemin descend sous la terre. Je regarde derrière moi. Je descends quelques marches et puis je descends, je descends encore, encore…
●
J’ai marché sans fin un dédale de chemins. Des couloirs de roche aux formes différentes, et sur leurs murs des lanternes sont accrochées parfois, c’est dans une trop lourde pénombre que j’avance et je ne sais pas où je vais, tandis que je me perds davantage encore. Le chemin qui va est traversé de brèches, d’ouvertures dans les flancs des parois, qui mènent à d’autres voies traversées par d’autres brèches. Je prends à droite. Il y a des voies et puis d’autres, des chemins creusés grossièrement dans la roche noire, d’autres plus larges, plus grands, plus anciens ? Je prends à gauche. Des escaliers qui descendent. Une salle aux colonnes d’acier. De vieilles poutres de bois retiennent le ciel au-dessus de moi. Quelquefois je peux sentir les murs me serrer les épaules, et je courbe le dos. Dans d’autres, la lumière des lanternes ne peut pas même dissiper l’ombre là-haut et je ne discerne pas leur hauteur. J’ai depuis que je suis entrée suivi de nombreux chemins, j’ai emprunté de nombreuses voies. Mes pas résonnent étrangement dans le silence des gravats sous mes pieds.
●
Je remarque mon corps taché qui se noircit aux bras et aux mains, car sur les murs où je m’appuie saigne du safrr, comme des larmes noires, elles coulent épaisses. Les hommes creusent les mines et les chemins qui descendent sous la terre pour récupérer des parois maculées le safrr, combustible qui alimente ma lampe, et toutes les autres, source la plus ancienne de lumière et de chaleur en Ambre et ailleurs. Il y a tant de chansons sur le safrr, tant de contes, tant d’histoires. Elles disent certaines que les hommes le volèrent aux dieux. D’autres que le safrr fut un don des Conteurs ou bien même d’Éru. D’autres encore racontent que le safrr est le sang noir qui tomba de la carcasse du jour et que la terre a bu. Et encore d’autres, que c’est la terre qui pleura avec les premiers hommes le meurtre du jour il y a très longtemps. Ce qui reste, ce qui compte est que le safrr fait que l’homme ne craint plus le noir ni la nuit.
●
J’avance lentement, mais pour autant ces voies sont-elles vraiment sans fin ? Je sens que je m’enfonce davantage sous la terre. Je m’enfonce encore. Je prends à gauche. Je me perds de plus en plus. Par où aller maintenant ? Quel chemin prendre ? L’angoisse me tord la gorge, m’attrape les boyaux et les noue. Encore un choix. Mes boyaux. Mes boyaux. Je pense, les chemins que je prends ressemblent à des boyaux. C’est dans les entrailles du monde que je marche.
●
Je m’arrête, car devant moi, c’est l’abîme, l’abîme qui s’étend. Le chemin poursuit sans lumière, mais ce n’est plus la pénombre, c’est plus terrible que l’absence de lumière, plus terrible, bien plus noir. Je décroche la dernière lanterne de la paroi et je pénètre dans l’abysse.
●
La lanterne a presque fini d’épuiser son essence. La flamme est mourante et l’abysse s’approche de moi.
●
La flamme est morte. Je suis dans les ténèbres. Ma main
contre la paroi, j’avance encore
●
à tâtons. De ma poche je sors une boîte d’allumettes. Il en reste douze. J’en craque une. La lueur vacille, et me brûle les doigts. Je la lâche brusquement et l’abîme l’avale.
●
Puis j’en allume une autre,
●
et je poursuis. Je continue dans le noir.
Elle meurt.
●
Je poursuis dans le noir.
À nouveau. Le craquement.
L’embrasement.
La lueur,
●
vacillement,
puis obscurité.
●
Encore une allumette,
encore les ténèbres.
●
●
Encore une allumette.
●
Puis la dernière.
Je la laisse me brûler les doigts.
●
L’abîme m’enveloppe et je reste figée.
●
Une main sur la paroi.
●
Je l’effleure marchant,
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
✹
Lueur,
une figure danse sur le mur,
derrière ma main qui l’effleure,
court le dessin d’un soleil,
d’un petit, très petit soleil,
joyeux.
✻
☼
✸
❊
Un autre ❈ le suit.
Encore un autre soleil, puis un autre encore,
❋ qui se dessine sur la paroi des roches noires.
Des soleils dansent sur les parois. ❋
✷ ✵
☼ ❋
✸ ✹
● ✻
✷
❋ ❁ ✸ ❋ ✸
☼
❈ ✵
✶ ✹
✷
✺ ✸ ✲ ❈
❈
✵
✺
✺ ❁
✺
✸
☼ ✺ ❋
✸ ❊ ❁
●
Mille soleils ❋ ❃
❋ ✵
✺ ✸
✷ ✸
✻
Mille ✷ soleils dansants, ☼
❃
☼ ✸
●
☼
❊ ✺
mille soleils dansants pour moi ✺
● sur les parois.
❋
●
✷
Dans le chemin sombre
qui va sous la terre, ✸
les murs, le sol,
le ciel se couvrent de mille et mille soleils,
✷
●
✷
✸
mille soleils dansants, ❊ ●
❋
alors je vis un ciel immense.
Un ciel immense sous la terre
●
❃
Le ciel était immense et dans le ciel dansaient des milliers et des milliers de soleils. Inénarrables étaient leur lumière, et leur danse sous la haute voûte du monde. Et sous ce ciel était une ville de pierre blanche qui s’élevait jusqu’aux hautes sphères, et les soleils étaient partout autour de cette tour. J’entrais dans la ville de gloire et partout une musique résonnait comme un tressaillement, et cette musique n’était pas des hommes. L’écho des trompettes célestes faisait trembler les murs mais j’étais sans peur. Et la joie était toute puissante dans la ville que je gravissais. Dans cette lumière n’existait aucune ombre. Il n’y avait aucune obscurité. J’arrivais tout en haut et je voyais alors le roi de ce royaume, et c’était un pêcheur, il réparait un filet sur un trône d’or, un roi pêcheur. Autour de lui des femmes et des hommes par centaines de milliers vêtus de blanc qui jouaient de leur flûte et chantaient pour la gloire de ce roi. Et la musique s’éleva dans tout le royaume et dans le ciel, et les soleils firent une grande ronde. À travers les arches, je regardais les soleils et le ciel.
●
J’étais à nouveau dans le noir, il n’y avait aucune lumière.
●
●
●
quatrième jour ?
« Il n’y a plus personne, Retiens-toi d’appeler.
La nuit est tombée, Leurs portes sont fermées,
L’herbe a recouvert les marches,
Il n’y a plus personne.
Avec qui vas-tu aller, Dans cette nuit toute noire ?
Avec qui ? Il n’y a pas plus d’amis Ni tu as de feu ;
Si j’avais allumé la lampe sous l’arche,
Quelqu’un l’aurait peut-être vue.
Mon cœur, mon cœur, Je suis fatiguée cette fois,
Qu’est-ce qui te prend, qu’est-ce que tu as,
Mon cœur, qu’est ce que tu as ?
Mon cœur, Il n’y a plus personne. »
Il y a longtemps, sans compte des heures, que je demeure dans ce noir. Mais voici, maintenant, j’entends une voix, un chant d’une grande peine. Ce n’est qu’un son au loin, bientôt, j’entends la voix s’approcher et devenir un écho qui résonne et les chemins sombres s’emplissent d’amertume et de beauté. Je reste assise, figée dans le noir. Je ne fais aucun bruit, j’ai si peur qu’à découvrir ma présence elle cesse son chant. Pourtant il faudrait crier, appeler son aide, mais je ne veux pas interrompre sa voix. Sait-elle que je suis là ? De sa complainte, je discerne les mots de la femme qui s’approche de moi. Il me semble que sa voix est pleurante et je surprends sur mes joues quelques larmes amères. C’est l’histoire des premiers temps, quand le premier jour ne revint pas des morts, quand les hommes souffrirent la première nuit du monde ; son chant conte comment l’un d’eux ne la supporta pas, et descendit dans le monde d’en bas, sous le monde, dans le ventre de la terre, pour ne plus voir le ciel d’abîme, pour fuir la nuit, celui-là qui se nommait Ramarr sous la terre. Maintenant je sens qu’elle est proche, dans la même galerie, plus loin. Elle a dû me deviner car elle s’arrête de chanter, et continue de s’approcher. Je me lève, et crie mon nom. Elle allume une lampe, et je vois alors son visage. Sa peau claire est pâle, et son visage gris perle me sourit. Ses avant-bras, ses mains, ses jambes, ses pieds nus, sont complètement noirs. Elle me demande qui je suis. Je lui raconte mon histoire. Je la suis. Sa lumière me fait tant de bien. Son nom est Samarr.
●
Samarr marche souvent seule sous la terre, par tous les chemins qui sont. Elle marche sans lumière, m’explique-t-elle, car elle aime écouter le bruit des pierres qui ne parlent que dans le noir. On change souvent de galerie, de grandes voies suivent d’étroits passages, elle sait où l’on va, elle me dit connaître toutes les voies sous la terre et je la crois. Les boyaux étroits de pierre et de gravats que nous traversions sont devenus des salles aux murs taillés, et sous les hauts plafonds je rencontre un peuple. Dans les crevasses pleines de lumière que des ponts traversent, au-dessus de moi, en dessous de moi, partout dans les flancs creusés et dans les chemins éclairés, des hommes, des vieillards, des femmes, des mères, c’est un peuple qui vit ici sous le monde. Je traverse une ville lovée dans les entrailles de la terre. Mille petites lumières brillent tout autour de nous, de chaque fenêtre creusée, de chaque entrée s’échappe la lueur des lampes, d’autres pendent partout comme d’énormes astres depuis les plafonds qui se perdent dans l’infini au-dessus, d’autres sont par milliers accrochés à des chaînes tendues qui courent les murs et les espaces du vide. Tous ont les avant-bras noirs, tachés pour toujours par le safrr. Car j’apprends, le safrr laisse avec le temps une trace ineffaçable. Je mange à la table d’une famille, un repas est dressé pour moi. Ces gens creusent la terre depuis toujours. Ils m’apprennent et j’entends la fierté de la trace du safrr sur leur peau, trace d’un ancien pacte, d’une ancienne alliance des hommes avec la terre, de ceux qui firent du safrr la première lampe, et le premier des soleils des hommes. Le safrr porte la trace de la lutte des hommes pour l’aube, et tout cela, les hommes le racontent encore, et le souvenir ancien de ces jours ne s’est pas perdu. La trace du safrr est prégnante, il est chose précieuse, le cœur et les larmes de la terre, le soleil et les étoiles des hommes d’en bas.
●
Je traverse avec Samarr les galeries ornées, les escaliers de pierre taillée, les lampes ouvragées plus grandes qu’un homme qui pendent dans les grandes salles de ces palais souterrains. Je traverse tant et tant de chemins. Je voudrais entendre Samarr chanter. Elle accepte, et je vois à nouveau la tristesse, et ses yeux amers, se saisir de son visage et de sa voix. Sa voix s’élève et poursuit le chant qui me sortit de l’abîme où je m’étais perdue. Elle raconte la première Aube. Après un temps, sa voix se tait. Elle n’a jamais vu le jour qui recouvre le monde, sa peau n’a jamais senti la chaleur du soleil des hommes. Elle me dit encore qu’elle est née ici, sous la terre, comme ceux de sa génération, et la précédente. Mais cela n’a pas toujours été. Depuis la grande guerre qui condamna, à la défaite du peuple, les Noires-mains et les leurs à l’exil sous le monde où ils s’enfouirent, depuis lors, ils attendent…
Nous marchons longtemps comme cela. Et je demeure sans peur avec elle qui connaît toutes les voies sous la terre.
●
Elle me guide jusqu’à un des chemins vers la surface pour que je poursuive mon voyage. Peu avant dans le dernier passage sombre, elle s’arrête, elle ne souhaite pas s’avancer plus. Elle veut attendre avant de voir le jour. Elle attend le jour où tous se lèveront, et que la guerre reprendra, pour qu’ils retournent vivre sous le soleil qui pour eux aussi fut mis au ciel. Je regarde Samarr au visage triste et mon cœur est amer. Elle me souhaite bonne route. Je la remercie, puis m’en vais.
●
cinquième jour
Il n’est pas encore tout à fait le matin quand je sors. Je retourne à la ville avec le désir de quitter ce pays. Je me dirige vers la gare qui m’emmènera loin. La ville n’est pas encore levée, et le matin avec elle tarde aussi aujourd’hui. Les feux de la nuit ne sont pas tous éteints, de fins filets s’élèvent des torches et des falots. J’avance dans les rues désertées. Je sens la brûlure de la fatigue dans mon corps sans sommeil.
●
La gare est de taille fabuleuse. Dans ses hautes arches se perd une voûte arquée, que la clarté de l’aube transperce mille fois de rayons obliques. Je suis comme dans le ventre d’un poisson qui m’aurait avalée et je regarde les longues arêtes comme une cage. La gare est pleine de bruit et de furieuses fumées qui s’élancent violemment des machines d’aciers, et le sol frémit sous mes pieds. Elle est pleine d’hommes qui travaillent et chargent les trains de marchandises, la plupart versent dans les larges cuves sur le dos des rames le safrr raffiné. Les trains, ils partent pour toutes les contrées, et tous les bouts de ce monde étroit. Dans l’un d’eux je monte, celui dont les naseaux crachent les fumées du départ. Je m’installe dans un coin. Sur les sièges autour de moi d’autres hommes s’installent. Le train siffle, une onde le parcourt, crissement, ébranlement et puis s’en va. Contre la vitre froide, je m’endors rapidement malgré le tumulte, malgré le cahot.
●
Le train longe la mer que je regarde longuement. Il passe au-dessus des ponts et coupe les vallées. La mer toujours pareille s’étend lointaine, à la couleur verte. Heures douces mais ce pays est petit, je vois s’approcher la chaîne de montagnes qui marque la frontière. Le train pénètre dans la montagne par un souterrain, et soudain plus aucune lumière. L’obscurité et le bruit me rappellent une vieille histoire : avant le commencement, quelqu’un, dans les palais du Vide, au premier néant chanta une chanson, et de cette chanson serait né le monde…
Le bruit dehors est si fort, il me semble que la terre se déchire.
●
Les contreforts trop hauts encore et abrupts de ce versant froid forcent le train à se glisser par de nombreux chemins souterrains. Quelques heures ont passées, le paysage de sommets bleus est devenu colline, et puis c’est déjà plus que la plaine sereine qui gondole doucement. Nous apercevons la première ville frontalière. Le train s’arrête pour décharger un peu son fardeau marchand. Je reste à l’intérieur. Un homme monte, aux vêtements de toile bordeaux. Il porte un béret à l’allure officiel, et face à moi il s’assoit.
●
Ce que je vois par la fenêtre du paysage qui défile me perturbe. Les champs sont maigres, et les hautes herbes les habitent. Il n’y a personne dans les champs clairsemés. Où sont passés les blés argentés ? L’homme aux vêtements rouges soudain parle et voici ce qu’il me dit :
« Ce pays va mal, tu le vois n’est-ce pas. Tu n’es pas d’ici, aussi, sache que ce pays se nomme les Champs d’Argent. »
« Sache que son sol, cher étranger, est fécond, et généreuse la terre fut toujours pour nous. Sur le ventre fertile de nos plaines qui s’entendent à l’infini, nous avons creusé profondément les sillons de nos champs et avons semé le pain, nous récoltions à l’abondance. Apprends que le labour est notre chant et que la terre qui germe était notre hymne. »
« Étranger, que tu n’es venu avant ! Tu aurais vu, en cette saison, les épis se courbaient sous le vent, qui dans ce pays souffle et n’arrête jamais son souffle. Caressant les blés, l’onde les parcourait et donnait l’impression d’une mer mouvante verte et grise. Comme mon cœur pleure à ce souvenir, étranger. »
« Ce pays va mal. Le temps des semailles a passé, nous avons attendu en vain. Nous avons plongé nos charrues dans la terre arable comme on laboure la mer, car de la terre plus rien ne sortit. Ce pays va mal, sa terre meurt. »
« Mon gouvernement m’a envoyé, pour lui, je parcours les provinces et les confins du royaume. Depuis l’ouest d’où je viens, jusqu’à l’extrême-est où ce train va, on m’a envoyé pour mesurer l’étendu de la plaie du mal qui dévore notre pays. Et partout où mon regard s’est porté, c’est la même désolation que j’ai vue. Mais ce n’est pas ma patrie seule qui va mal, mais le monde, étranger, et la ruine que j’ai vue partout était la même. »
Et je restais ainsi, écoutant cet homme.
●
sixième jour
Par la fenêtre, l’aube blanche et l’écume. La plaine crache son haleine d’albâtre sur l’étendu. Un soleil craintif se lève sur les champs morts aux herbes mortes, je crois avoir dormi mille ans. Le train court la plaine et strie la terre cendreuse. Plusieurs fois, je vois des villages au loin. Par instants, j’aperçois des personnes qui marchent, ce sont des groupes plus nombreux parfois. Toujours ils vont dans la même direction vers l’est, pareille à ce train.
●
Le train s’est arrêté dans une ville mais depuis il ne repart pas, un bruit inquiet parcourt les rames. L’homme de la veille sait que le train ne poursuivra pas sa route. Il est préoccupé, je sens le poids des choses sur son corps. Il n’y a personne dans la gare, me dit-il. Je le vois s’en aller vers les ouvriers mécaniciens du train qui essuient leur front anxieux ombreux de suie. Je descends du train et m’avance dehors. Rien ne hante les rues de cette ville abandonnée, des fenêtres, pas de lumières qui vivent ou trahissent la vie. Les murs serrés pleurent une inquiétante chanson quand le vent s’engouffre violemment dans la gorge des voies. Je souhaite alors plus que tout partir d’ici. Dans mon ventre il y a comme des nœuds, ce lieu est chose mauvaise, la ville est grande, et pourtant pas une âme ? Je me souviens des gens que je voyais marchant toujours vers l’est, je vais suivre leur direction. J’irai comme eux vers le levant.
●
Le sol a la couleur cendre d’une boue argentée. Je comprends alors le nom de ce pays. Je foule une terre glabre et grise. Les hautes herbes qui la couvrent parfois sont déjà mortes et leurs tiges dures cachent des ronces et les épines me font chaque pas pénible. Où est passée ta chaleur, Soleil frileux ?
●
Le soir tombe, j’ai si froid. Le vent ne cesse jamais de souffler, il n’interrompt jamais son cri et sa morsure traverse ma chair, et mes os, et je frissonne, si proche de me briser. Je ne veux pas voir le soir tomber, je voudrais tout faire et retenir le jour. Le soir tombe et mon cœur se déchire, des larmes coulent. Je frémis, j’ai si peur de ce soir qui tombe. Je continue de marcher pour sauver mon corps de la gelure. Allant vers l’est, j’avance vers le point le plus sombre du ciel, vers le point d’où s’écoule la nuit.
●
J’avance à grande peine. Si je tombais sans doute je resterais au sol, et je fermerais les yeux, et le sommeil me prendrait et ne me rendrait pas, et ce serait bien. Mais au-dessus de moi, le vent qui souffle a chassé de la voûte les nuages ennemis et je peux voir alors les étoiles. Le froid fait leurs lueurs vivantes, emplissant mon cœur d’un vertige. Sous le ciel tremblant, sur la terre et sous la terre, et ni la mer et ni le jours, je n’aime rien plus que les étoiles d’Éru. Les étoiles ne sont pas dans le monde, elles ne lui appartiennent pas. Elles se tiennent en dehors dans les Brumes. Dans la longue nuit fut chantée leur lueur afin qu’elle perce le manteau de sang noir qui s’écoulait du corps du Jour. Car il aimait les hommes ses enfants, il les fit.
●
Il fait très froid. Loin devant moi, une lueur rouge vacillante. Je m’approche et la lueur se divise en plusieurs foyers rougeoyants. Ce sont des feux contre le froid, autour d’eux des hommes se tiennent proches, autour des hommes est pour la nuit un camp de misère. J’entre et je vois, des toiles, des charrettes, des couvertures, et des hommes, des femmes qui dorment ou qui essaient. Puis proches d’un feu, quelques têtes se hochent pour me dire que l’on m’a vue, que je peux rester. Je me tiens très près du feu, je sens sa flamme fidèle me brûler et me ramener à la vie. Dans cette nuit au demi-sommeil, le feu seul parle, il fait même beaucoup de bruit, et tout le reste sous l’obscurité n’est que silence livide, sur les visages et les corps, et dans le dehors, pas de bruit. Les bœufs, les chevaux, rien ne souffle plus qu’il ne faut. Une grande tristesse comme une chape écrase jusqu’au sourire des flammes.
●
septième jour
Il n’y a pas de joie dans le ciel gris et bas qui se lève ce matin, il a pris pour lui la couleur de la terre morose. On me partage la nourriture d’un repas frugal. Le froid fait nos souffles courts. Puis nous levons les toiles et les tentes, nous chargeons les charrettes, sur lesquelles nous asseyons les anciens et les enfants. Nous devons être une centaine, un peu moins. Ceux qui ont rejoint le groupe comme moi sont nombreux. La longue caravane reprend la route. Où vont-ils ? Ils vont là où le soleil se lève, à l’est, et qu’y cherchent-ils ? Je ne sais pas encore.
Une femme ordonne tout cela et prononce des instructions. Elle se tient à la tête de cette foule aux visages mornes, je la vois, il s’épand d’elle quelque chose de grand. Sa voix. Dans sa voix est une grande magie. Je demande son nom à l’homme qui marche à côté de moi, elle s’appelle Mariam Élise. Son nom résonne. Elle n’est pas jeune, quelques cicatrices se mêlent aux discrets sillons de son visage abîmé mais sans âge. Si je dis « elle n’est pas jeune », c’est parce qu’il semble émaner de cette femme une histoire trop profonde pour que son âge puisse être inférieur à quelques milliers d’années. Elle doit avoir depuis toujours été là, être là depuis le commencement, depuis le début, et personne n’a pu être avant elle, voilà ce que je me dis. Tous la suivent. L’homme qui marche à côté de moi me raconte comment, lorsque Elle a traversé son village qui mourrait, Mariam Élise s’est avancée, et leur a proposé de venir avec elle et le groupe.
Mariam Élise s’est avancée et a dit : « Je suis venue pour vous sauver. »
Ils l’ont suivie. Et l’homme ajoute encore que c’est sa voix, sa voix qui les a armés du courage de partir. Oui sa voix, je l’entends, dans la voix de Mariam Élise, loge une grande magie. Elle n’est pas grande de taille, ses cheveux longs, très noirs, légèrement bleus, elle les attache derrière sa nuque. Sa seule présence souffle quelque chose de l’espoir, et cela vient lutter durement, avec force, et cruellement contre la misère du paysage qui s’étend, contre la désolation dans les cœurs, contre ce ciel trop bas, contre ce soleil trop faible. Ses bras sont couverts de son large manteau mais je crois apercevoir, dans un mouvement, ses doigts et sa main noire.
●
Je sais désormais que nous allons vers la mer de l’est. Vers là où repose la ville de Rajav, sur l’isthme du continent qui se jette dans la grande mer, jusque très loin dans l’est. Et ce lieu est le plus proche de l’extrémité du monde. Sur la mer de l’est, semblerait, certains connaissent d’autres voies sur la mer pour quitter le monde, d’autres voies pour les marches qui attendent dans les plis des Brumes. Voilà ce que j’entends autour de moi. Dans le reste de la journée, d’autres groupes se joignent à nous. Parfois ce ne sont que quelques personnes. Mariam Élise parle avec eux, et puis nous leur partageons ce que nous avons, la chaleur, à manger et à boire. Notre longue colonne s’allonge davantage, la caravane grandit et s’effile. Nous sommes deux fois le nombre que j’avais trouvé la première nuit où je les ai rejoints. Nous traversons ainsi dans la boue cendrée, un paysage de ruine. Nous passons au travers de villages déserts. La caravane continue, et continue, et s’allonge, et s’étire mais derrière Mariam Élise elle se maintient. Ce peuple qui a tout quitté, la terre et le pays, pour vivre, ou au moins arracher quelques jours et quelques semaines de plus à ce monde qui finit.
Pour tuer le temps, une vieille femme me raconte l’histoire qu’elle invente d’un royaume et de son Roi qui ne mourrait pas, et le soleil de ce royaume était figé dans sa course pour toujours. Comment ferais-je pour rejoindre un tel royaume ? Et dans notre ciel à nous, le soleil poursuit son terme qui mène le jour à sa fin, et la nuit dans une autre nuit.
●
Au soir, dans le campement, lové dans le ravage du monde,
une flûte quelque part s’est mise à chanter,
sa plainte a déchiré la nuit,
Alors, je me suis rappelé une chanson qui dit :
N’entre pas dans la nuit sans un cri ;
À la ruine du jour,
Que l’homme remue,
Qu’il incendie.
Emporte-toi et rage.
Quand bien même à leur fin,
Les hommes savent, ils sont sages,
Que finir est bien ; Car dire ne fut rien,
Et ne fit rien naître. Et cependant
Ils n’entrent pas dans la nuit sans un cri ;
Les hommes, les derniers qui viennent,
Crient combien oh peut être !
Leurs actes auraient pu danser
Dans des havres et sur les eaux. Alors
Emporte-toi et rage contre la nuit qui vient.
Les hommes qui chantent,
Qui s’emparèrent dans son vol
Du Soleil moite dans leurs mains,
Ils apprennent qu’il est mort. Mais
N’entre pas dans la nuit sans un cri.
Les hommes, leurs visages graves,
À la brisure profèrent bas que les yeux
Que l’on crève sont des feux, des météores,
Des étoiles qui filent… Et pourtant pourtant
Emporte-toi contre la nuit qui vient.
Couvre-moi de tes larmes. Mais, je te prie,
N’entre pas dans la nuit sans un cri.
Remue et incendie,
Emporte-toi et rage,
Que ce qui meurt,
Ne meurt pas sans bruit.
Je me suis éloigné,
et j’ai pleuré.