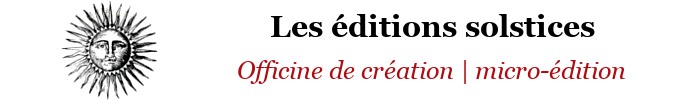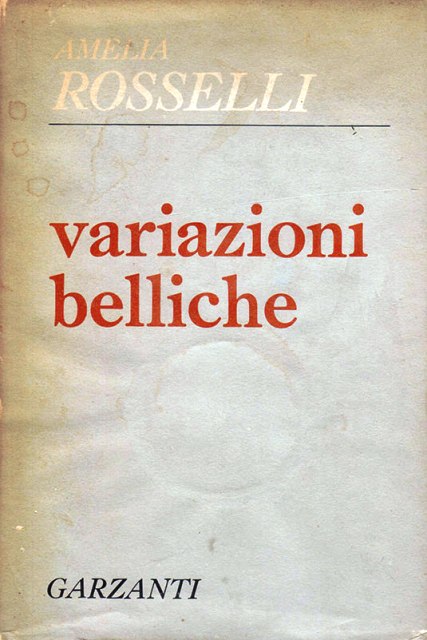Publié en 1964 chez Garzanti, Variazioni belliche paraît avec une préface de Pier Paolo Pasolini qui a marqué longtemps la réception d’une poésie difficile.
Le recueil est paru en France, chez Ypsilon en 2012, dans la traduction de Marie Fabre.
Celles qui suivent sont reprises du numéro 9 de la revue La Barque avec notre traduction.
*
nullo
è il deserto in cui tu mi muovi, e le false facce di
quella cattedrale tu chiami l’ardore
di Dio
s’incoronano di spine mortali. E se il sicuro
ormeggiare della tua candela di notte si
spezza, incolpa il fato, la notte oscura, e le
povere tue
spostate ragioni.
rien
est le désert dans lequel tu me meus, et les fausses faces de
cette cathédrale que tu appelles l’ardeur
de Dieu
se couronnent d’épines mortelles. Et si le sûr
amarrage de ta bougie de nuit se
casse, accuse le destin, la nuit obscure, et tes
pauvres
raisons déplacées.
*
la mia fresca urina spargo
tuoi piedi e il sole danza ! danza ! danza ! – fuori
la finestra mai vorrà
chiudersi per chi non ha il ventre piatto. Sorridente l’analisi
si congiungerà – ma io danzo ! danzo ! – incolume perché
‘l sole danza, perché vita è muliebre sulle piantogioni
incolte se lo sai. Un ebete ebano si muoveva molto
cupido nella sua
fermezza : giro ! giro ! come tre grazie attorno al suo punto
d’oblio !
mon urine fraîche je répands
tes pieds et le soleil danse ! danse ! danse ! – dehors
la fenêtre jamais ne voudra
se fermer pour qui n’a pas le ventre plat. L’analyse souriante
se reliera – mais moi je danse ! je danse ! – indemne parce que
le soleil danse, parce que la vie est féminine sur les plantations
incultes si tu le sais. Un ébène hébété bougeait très
cupide dans sa
fermeté : je tourne ! je tourne ! comme trois grâces autour de son point
d’oubli !
*
Quello stormire violento di uccelli, quel loro vezzoso
rialzarsi in sciami dagli alberi più duri
(ruggisce il tenero leone in una volata di pensieri
e la mia fede s’accende) quel loro posarsi sulle punte più sottili
quel loro abbandonarsi con lo sguardo distratto, questo
è il tuo desio, che sorvola sui miei monti d’angoscia
questo è il tuo caldo filo d’angoscia
che non sa.
Ce bruissement violent des oiseaux, leur ravissant
soulèvement en essaim des arbres les plus durs
(le tendre lion rugit dans une envolée de pensées
et ma foi s’embrase) leur pose sur les pointes les plus subtiles
leur abandon avec un regard distrait, c’est cela
ton désir, qui survole mes monts d’angoisses
c’est cela ton fil chaud d’angoisse
qui ne sait pas.
*
Se l’anima perde il suo dono allora perde terreno, se l’inferno
è una cosa certa, allora l’Abissinia della mia anima rinasce.
Se l’alba decide di morire, allora il fiume delle nostre
lacrime si allarga, e la voce di Dio rimane contemplata.
Se l’anima è la ritrosia dei sensi, allora l’amore è una
scienza che cade al primo venuto. Se l’anima vende il suo
bagaglio allora l’inchiostro è un paradiso. Se l’anima
scende dal suo gradino, la terra muore.
Io contemplo gli uccelli che cantano ma la mia anima è
triste come il soldato in guerra.
Si l’âme perd son don alors elle perd du terrain, si l’enfer
est une chose certaine, alors l’Abyssinie de mon âme renaît.
Si l’aube décide de mourir, alors le fleuve de nos
larmes s’élargit, et la voix de Dieu demeure contemplée.
Si l’âme est la répugnance des sens, alors l’amour est une
science qui arrive au premier venu. Si l’âme vend son
bagage alors l’encre est un paradis. Si l’âme
descend de sa marche, la terre meurt.
Je contemple les oiseaux qui chantent mais mon âme est
triste comme le soldat en guerre.
*
Contro del magazziniere si levava il grido dell’incoscienza
contro del pourboire coniavo un’altra frase, quella dell’incertezza.
Contro dell’odio ringraziavo e perdonavo, contro della
tristezza imbracciavo un altro pugnale. Contro delle lacrime
furtive innalzavo la veracità ; contro della lacrima del
soldato una ragazza potente che non sapeva nemmeno dov’era
l’usgnolo, l’usignolo potente e solitario. In nome di Cristo
e della Vergine Maria che la tua santità sia fatta, così
com’è il gioco di ogni giorno. Contro della debolezza che
si rinsaldi la fede, contro dell’elefante traboccante di
odio che sia fatta la volontà del cane che seppe quale
pesce pigliare. Trappola tesa ed arco rialzati e perdona
con un grido di allarme. Se sovente nella birra scorgevo
piccoli grappoli d’oro era invece la grazia che balbettava
parole sconnesse : fuori del linguaggio dei sensei abbandonati.
Contre le magasinier se levait le cri de l’inconscient
contre le pourboire je forgeais une autre phrase, celle de l’incertitude.
Contre l’oubli je remerciais et pardonnais, contre la
tristesse j’embrassais un autre poignard. Contre les larmes
furtives j’élevais la véracité ; contre les larmes du
soldat une jeune fille puissante qui ne savait même pas où était
le rossignol, le rossignol puissant et solitaire. Au nom du Christ
et de la Vierge Marie que ta sainteté soit faite, tel
qu’est le jeu de chaque jour. Contre la faiblesse que
se raffermit la foi, contre l’éléphant débordant de
haine que soit faite la volonté du chien qui sut quel
poisson attraper. Piège tendu en arc relève-toi et pardonne
avec un cri d’alarme. Si souvent dans la bière j’apercevais
de petites grappes d’or c’était au contraire la grâce qui balbutiait
des paroles décousues : en dehors du langage des sens abandonnés.
*
Contro d’ogni impero imperava un bisogno d’ordine. Contro
d’ogni pianeta era imperante il bisogno della libertà. Con
la fanciullaggine imperava ancora la notte che bisbigliava
parole forse amare. Con il tirocinio del parente avaro si
smuoveva la rivoltella dei rivoltosi. Con la luce accesa
smuoveva il catarro il vecchio filo di lana arrotolato nella
sostanza degli erdi. Sentivo le voci degli orologiai arrovellarsi
ma la fibra del mondo era la più costante misura della mia
malattia ! Era la più forte sostanza della mia credenza.
Contre toute domination dominait un besoin d’ordre. Contre
toute planète était dominant le besoin de la liberté. Avec
les enfantillages dominait encore la nuit qui murmurait
des paroles peut-être amères. Avec l’apprentissage du parent avare se
déplaçait le revolver des révoltés. Avec la lumière allumée
le catarrhe déplaçait le vieux fil de laine enroulé dans la
substance des héritiers. J’entendais les voix des horlogers s’agacer
mais la fibre du monde était la plus constante mesure de ma
maladie ! Elle était la plus forte substance de ma croyance.
*
Per la tua pelle olivastra per la tua mascella cadente
per le tue virginee denta per il tuo pelo bruno per il
tuo amore impossibile per il tuo sangue olivastro e la
mascella inferiore cadente per l’amministrazione dei beni
che non consiglia altre armonie, per l’amore e per il mistero
per la tua voracità e per la mia per il tuo sondare impossibile
abissi – per la mia mania di grandezza per il tuo irrobustire
per la mia debolezza per il tuo cadere e risollevarti
sempre si chiamerà chimera il breve viaggio fatto alle
stelle.
Pour ta peau olivâtre pour ta mâchoire tombante
pour tes dents vierges pour tes cheveux bruns pour ton
amour impossible pour ton sang olivâtre et la
mâchoire inférieure tombante pour l’administration des biens
qui ne conseille pas d’autres harmonies, pour l’amour et pour le mystère
pour ta voracité et pour la mienne pour ton sondage impossible
des abîmes – pour ma folie des grandeurs pour ton endurcissement
pour ma faiblesse pour ta chute et ton relèvement
toujours on appellera chimère le bref voyage fait aux
étoiles.
*
Se per il caso che mi guidava io facevo capriole : se per
la perdita che continuava la sua girandola io sapevo : se
per l’agonia che mi prendeva io perdevo : se per l’incanto
che non seguivo io non cadevo : se nelle stelle dell’universo
io cascavo a terra con un tonfo comme nell’acqua : se per
l’improvvisa pena io salvavo i miei ma rimanevo a terra
ad aspettare il battello se per la pena tu sentivi per
me (forse) ed io per te non cadevamo sempre incerti nell’avvenire
se tutto questo non era che fandonia allora dove rimaneva
la terra ? Allor chi chiamava – e chi rinnegava ?
Sempre docile et scontenta la ragazza appellava al buio.
Sempre infelice ma sorridente mostrava i denti. Se non
v’era aiuto nel mondo era impossibile morire. Ma la morte
è la più dolce delle compagnie. La più dolce sorella era
la sorellestra. Il dolce fratello il campione delle follie.
Si à cause du hasard qui me dirigeait je faisais des cabrioles : si à cause de
la perte qui continuait sa girandole je savais : si
à cause de l’agonie qui me prenait je perdais : si à cause du charme
que je ne suivais pas je ne tombais pas : si dans les étoiles de l’univers
je tombais à terre avec un bruit sourd comme dans l’eau: si à cause de
la peine imprévue je sauvais mes parents mais demeurais à terre
à attendre le bateau si à cause de la peine que tu ressentais pour
moi (peut-être) et moi pour toi nous ne tombions pas toujours incertains dans l’avenir
si tout cela n’était qu’un mensonge alors où demeurait
la terre ? Alors qui appelait – et qui reniait ?
Toujours docile et mécontente la fille appelait dans le noir.
Toujours malheureuse mais souriante elle montrait les dents. S’il n’
y avait pas d’aide au monde il était impossible de mourir. Mais la mort
est la plus douce des compagnies. La plus douce des sœurs était
la demi-sœur. Le doux frère le champion des folies.
*
Non so se di tra le pietre spuntate de la indifferenza
giaccia un tuo gemito : non so se fra le vergini chiome
cada una trombetta : onore, bagliore, precisione
della virtù ! Non so se di tra le pietra spuntate
della differenza, esista la commozione. Non rido non
piango non rido non chiamo tutto si disfa nell’ombra.
Non so se di tra le pennella rustiche del tuo
mentire, esista una differenza : tra me e te e il
belvedere. Non so se di tra te e me nel belvedere
esista una differenza. Io so che di tra me e
te esiste la gloria e la differenza. Si nasce e si
resite, – al servizio della libertà. Si muore e si rinasce,
forse al servizio della libertà : si muore e si rinasce
in orario.
Je ne sais pas si entre les pierres épointées de la indifférence
gît un gémissement de toi : je ne sais pas si parmi les vierges chevelures
tombe une trompette : honneur, lueur, précision
de la vertu ! Je ne sais pas si entre les pierres épointées
de la différence, existe l’émotion. Je ne ris pas je ne
pleure pas je ne ris pas je n’appelle pas tout se défait dans l’ombre.
Je ne sais pas si entre les pinceaux rustiques de tes
mensonges, il existe une différence : entre moi et toi et le
belvédère. Je ne sais pas si entre toi et moi dans le belvédère
il existe une différence. Moi je sais qu’entre moi et
toi il existe la gloire et la différence. On naît et on
résiste, – au service de la liberté. On meurt et on renaît,
peut-être au service de la liberté ; on meurt et on renaît
à l’heure.
*
Perché iddio (io) mi perdonasse era necessario
ch’io mangiassi. Nel mondo piscologico delle mie
idee, cadeva l’ultima stella. Nel mondo psicologico
delle mie idee era innata l’idea di dio. Nel mondo
psicologico della mia infanzia cadeva l’ultimo
dio. Nel mondo inglese della mia infanzia cadeva
la monade. La monade sorvegliava riccamente
il mondo.
Pour que dieu (moi) me pardonne il était nécessaire
que je mange. Dans le monde psychologique de mes
idées, l’ultime étoile tombait. Dans le monde psychologique
de mes idées l’idée de dieu était innée. Dans le monde
psychologique de mon enfance tombait le dernier
dieu. Dans le monde anglais de mon enfance tombait
la monade. La monade surveillait abondamment
le monde.
*
Se non è noia è amore. L’intero mondo carpiva da me i suoi
sensi cari. Se per la notte che mi porta il tuo oblio
io dimentico di frenarmi, se per le tua evanescenti braccia
io cerco un’altra foresta, un parco, o una avventura : –
se per le strade che conducono al paradiso io perdo la
tua bellezza : se per i canili ed i vescovadi del prato
della grande città io cerco la tua ombra : – se per tutto
questo io cerco ancora e ancora : – non è per la tua fierezza,
non è per la mia povertà : – è per il tuo sorriso obliquo
è per la tua maniera di amare. Entro della grande città
cadevano oblique ancora e ancora le maniere di amare
le delusioni amare.
Si ce n’est pas l’ennui c’est l’amour. Le monde tout entier m’extorquait ses
sens coûteux. Si pendant la nuit qui m’apporte ton oubli
j’oublie de me retenir, si dans tes bras évanescents
je cherche une autre forêt, un parc, ou une aventure : –
si sur les routes qui conduisent au paradis je perds ta
beauté : si dans les chenils et les évêchés du pré
de la grande ville je cherche ton ombre : – si pour tout
cela je cherche encore et encore – c’est pour ton sourire sournois
c’est pour ta manière d’aimer. Dans la grande ville
tombaient sournoisement encore et encore les manières d’aimer
les désillusions amères.
*
Contro degli dei brandivo una piuma. Brandivo a vuoto
una piuma che non scendeva dall’aria. Nell’aria vibrava
un megafono : – era iddio che parlava senza farsi vedere.
Nell’aria vibrava un megafono : – era iddio che bramava troppi
piaceri era iddio che studiava la legge della prosperità.
Contro d’ogni deo sorrideva la fortuna.
Contre les dieux je brandissais une plume. Je brandissais à vide
une plume qui ne descendait pas des airs. Dans l’air vibrait
un mégaphone : – c’était dieu qui parlait sans se faire voir.
Dans l’air vibrait un mégaphone : – c’était dieu qui désirait trop
de plaisirs c’était dieu qui étudiait la loi de la prospérité.
Contre tout dieu la fortune souriait.
*
Mare del bisogno, Cassandra
dagli istintivi occhi blu la mia prigionia tranquilla
è un rovescio del destino assai dolce assai implacabile.
Con tristezza indovino negli occhi del profeta una
medaglia che si rovescia al tocco dell’uomo. O Cassandra
le tue occhiaie sono le mie preferite celle di rassegnazione
e le tue labbra non suggeriscono altri tormenti che
tu non possa conoscere altrove che per questo mio
fragilissimo pensare.
Mer du besoin, Cassandre
aux yeux bleus et instinctifs ma tranquille prison
est un revers du destin extrêmement doux extrêmement implacable.
Avec tristesse je devine dans les yeux de la prophétesse une
médaille qui se renverse au toucher de l’homme. Ô Cassandre
tes cernes sont mes cellules préférées de résignation
et tes lèvres ne suggèrent rien d’autre que des tourments que
tu ne peux connaître ailleurs que pour ma pensée
si fragile.
*
Annexe : Espaces métriques
Une problématique de la forme poétique a été pour moi toujours liée à celle plus précisément musicale, et je n’ai en réalité jamais séparé les deux disciplines, considérant la syllabe non seulement comme lien orthographique mais aussi comme son, et la période non seulement comme une construction grammaticale mais aussi comme un système.
Définir la syllabe comme son est cependant inexact : il n’y a pas de « sons » dans les langues : la voyelle et la consonne dans les classifications de l’acoustique musicale se définissent comme « bruits », et ceci est naturel, vu la complexité de notre appareil phonético-physiologique, et la variation d’une personne à l’autre de la grandeur même des cordes vocales et des cavités orales, à tel point que jamais jusqu’à maintenant n’a été obtenue une classification phonétique autre que statistique.
Quoi qu’il en soit en parlant de voyelles généralement nous entendons sons, ou aussi couleurs, vu que souvent nous leurs prêtons les qualités du « timbre » ; et en parlant de consonnes ou de regroupement de consonnes, nous entendons non seulement leur aspect graphique mais aussi des mouvements musculaires et des « formes » mentales.
Mais si, des éléments repérables dans la musique et dans la peinture ressortent, et dans la vocalisation, seulement les rythmes (durées et pulsations) et les couleurs (timbres et formes), dans l’écriture et la lecture les choses sont un peu différentes : nous simultanément nous pensons. Dans ce cas le mot n’a pas juste un son (bruit) ; même, quelquefois, il n’en a pas du tout, et résonne seulement comme idée dans la pensée. La voyelle et la consonne, ensuite, ne sont pas des valeurs nécessairement phonétiques mais aussi simplement graphiques, ou composants de l’idée écrite, ou mot. Le timbre aussi ne s’ouït pas quand nous le pensons, ou le lisons mentalement, et les durées (syllabes) sont élastiques et imprécises, selon la scansion du lecteur, et selon des dynamiques individuelles, rythmicité et vélocité de pensée. Mieux, dans la lecture silencieuse, quelquefois tous les éléments sonores disparaissent, et la phrase même poétique est seulement sens logique et associatif, perçu avec l’aide d’une subtile sensibilité graphique et spatiale (espaces et formes sont silences et points référentiels de l’esprit).
C’est ainsi que me trouvant devant une matière sonore ou logique ou associative dans l’écriture, jusqu’à présent classifiée ou abstraitement ou fantastiquement, mais jamais systématiquement, on me parle de « pieds » et de phrases, sans me dire ce qu’est une voyelle. Bien plus : la langue dans laquelle j’écris encore et encore est unique, alors que mon expérience sonore logique et associative est certainement celle de tous les peuples, et réflexive dans toutes les langues.
Et ce sont avec ces préoccupations que je me mis à un certain moment de mon adolescence à chercher les formes universelles. Pour les trouver je cherchai d’abord mon (occidental et rationnel) élément organisateur minimal dans l’écriture. Et celui-ci se révélait clairement être la « lettre », sonore ou non, timbrique ou non, graphique ou formelle, symbolique et fonctionnelle à la fois. Cette lettre, sonore mais également « bruit », créait des nœuds phonétiques (chl, str, sta, biv) pas nécessairement syllabiques, qui étaient en fait seulement des formes fonctionnelles ou graphiques, et des bruits. Pour une classification non graphique et formelle il était nécessaire, dans la recherche des fonds de la forme poétique, de parler au contraire de la syllabe, comprise assez peu scolastiquement, mais plutôt comme particule rythmique. Progressant dans cette matière encore insignifiante, j’en arrivais au mot entier, compris comme définition et sens, idée, puits de la communication. Généralement le mot est considéré comme la définition d’une réalité donnée, mais on le voit plutôt comme un « objet » à classifier ou à sous-classifier, et non comme idée. Moi au contraire (et ici peut-être je ferais bien d’avertir que mon mode d’expérimentation et de déduction étant très personnels, toute conclusion que j’ai pu en tirer est à prendre cum grano salis), j’avais de toutes autres idées à ce sujet, et j’allais jusqu’à considérer « le » et « la » et « comme » comme des « idées », et non simplement comme des conjonctions et des précisions d’un discours exprimant une idée. Je déclarais d’abord que le discours entier indiquait la pensée même, et donc que la phrase (avec tous ses coloris fonctionnels) était une idée devenue un peu plus complexe et maniable, et que la période était l’exposition logique d’une idée non statique comme celle matérialisée dans le mot, mais plutôt dynamique et « en devenir » et souvent même inconsciente. Voulant élargir ma classification trop peu scientifique, j’insérais l’idéogramme chinois dans la phrase, et le mot, et je traduisais le rouleau chinois en un délirant cours de la pensée occidentale.
Plus tard je me pris à observer la mutation de ce délire ou rouleau dans ma pensée selon la situation que mon cerveau affrontait à chaque instant de la vie, à chaque déplacement spatial ou temporel de mon expérience pratique quotidienne. Je remarquais d’étranges concentrations dans la rythmique de ma pensée, d’étranges arrêts, d’étranges coagulations et changements de temps, d’étranges intervalles de repos ou d’absence d’action ; nouvelles fusions sonores et idéelles selon le changement de temps pratique, des espaces graphiques et des espaces m’entourant continûment et matériellement. Dans le discours et dans l’écoute d’autres présences mentales ou psychologiques se tenant avec moi dans un même espace, la pensée devenait plus tendue, ou plus fatiguée, presque complémentaire à celle de l’interlocuteur même, se renouvelant ou se fondant avec lui dans cette rencontre.
Je tentai d’observer chaque matérialité externe avec la plus complète minutie possible dans un immédiat laps de temps et d’espace expérimental. À chaque déplacement de mon corps j’essayais d’ajouter un « cadre » complet de l’existence qui m’entourait. L’esprit devait assimiler l’entière signification du cadre dans le temps où il y demeurait, et y fondre sa propre dynamique intérieure.
Dans l’écriture, jusqu’à ce moment-là, ma complexité ou complétude face à la réalité était subjectivement limitée : la réalité était la mienne, non celle aussi des autres : j’écrivais des vers libres.
En effet dans l’interruption du vers même long, à n’importe quelle terminaison de phrase ou à n’importe quel mot déconnecté, j’isolais la phrase, en la rendant significative et forte, et j’isolais le mot, en lui rendant son idéalité, mais je scindais le cours de ma pensée en strates inégales et en sens déconnectés. L’idée n’était plus dans le poème entier, selon un instant de réalité dans mon esprit, ou dans la participation de mon esprit à une réalité, mais elle se déchirait en degrés lents, et n’était retraçable seulement qu’à la fin, ou nulle part. L’aspect graphique du poème influençait l’impression logique plus que ne le faisaient le moyen ou le véhicule de ma pensée, c’est-à-dire le mot ou la phrase ou la période.
Quant à la métrique, étant libre elle variait complaisamment selon l’association ou le plaisir. Ne souffrant pas de dessein préétabli, irréductible à eux, elle s’adaptait à un temps strictement psychologique musical et instinctif.
Par hasard je voulus relire ensuite les sonnets des premières écoles italiennes ; fascinée par la régularité je voulus retenter l’impossible.
Je repris en main mes cinq classifications : lettre, syllabe, mot, phrase et période. Je les encadrai dans un espace-temps absolu. Mes vers poétiques ne purent plus échapper à l’universalité de l’espace unique : les longueurs et les temps des vers étaient préétablis, mon unité organisatrice était définissable, mes rythmes s’adaptaient non seulement à mon bon vouloir mais aussi à l’espace déjà décidé, et cet espace était complètement recouvert d’expériences, de réalités, d’objets, et de sensations. En transposant la complexité rythmique de la langue parlée et pensée mais non scandée, à travers de nombreuses variations de particules timbriques ou rythmiques entre un espace typique, unique et limité, ma métrique à défaut de régularité était au moins totale : tous les rythmes possibles imaginables remplissaient minutieusement mon cadre à profondeur timbrique, ma rythmique était musicale jusqu’aux ultimes expérimentations du post-webernisme, ma régularité, quand il y en avait, était contrastée par un fourmillement de rythmes traduisibles non en pieds et en mesures longues ou courtes, mais en durées microscopiques juste à peine notables, si l’on voulait, avec un crayon sur du papier millimétrique. L’unité basique du vers n’était pas la lettre, désagrégeante et insignifiante, ni la syllabe, rythmique et mordante quoique toujours sans idéalité, mais plutôt le mot entier, de n’importe quel genre indifféremment, les mots étant considérés tous de valeur et de poids égaux, tous à manipuler comme des idées concrètes et abstraites.
Dans la tension de la première ligne du poème je fixais définitivement la largesse du cadre à la fois spatial et temporel ; les vers suivants devaient s’adapter à une égale mesure, à une formulation identique. En écrivant je passais de vers à vers sans m’occuper d’une quelconque priorité de sens dans les mots posés, par hasard, en fin de ligne.
En réalité pour m’aider à mesurer ou terminer ma ligne il y avait toujours ce point caché de la limite droite de mon cadre, et sur laquelle elle pouvait tomber, et par conséquent fermant la ligne, ou le mot entier, ou un quelconque lien orthographique lui aussi signifiant puisque réellement existant comme temps d’« attente » soit dans la parole soit dans la pensée. L’espace vide entre mot et mot était considéré en revanche comme non fonctionnel, et il n’avait pas d’unité, et si par hasard celui-ci tombait sur le point limite du cadre, il était immédiatement suivi d’un autre mot, de façon à remplir complètement l’espace et fermer le vers. Le cadre en fait était à recouvrir complètement et la phrase était à prononcer d’un souffle et sans silence ni interruption ; ce qui reflétait la réalité parlée et pensée, là où à l’oral nous lions nos paroles et dans la pensée nous n’avons pas d’interruptions, exceptées celles explicatives et logiques de la ponctuation. Je pensais en fait que la dynamique de la pensée et de l’oralité s’épuise généralement en fin de phrase ou de période ou de pensée, et que l’émotion vocale et l’écriture auraient suivi donc sans interruption cette manière de naître et de renaître.
Dans la lecture à voix haute chacun des vers était ensuite à phonétiser à l’intérieur de limites identiques de temps, correspondant elles-mêmes aux égales limites de longueur et de largeur graphiques préalablement formulées par la texture du premier vers. Même dans le cas où un vers aurait contenu plus de mots, syllabes lettres et ponctuations qu’aucun autre, le temps total de la lecture de chaque vers devait rester autant que possible identique. Les longueurs des vers étaient donc approximativement égales, et avec elles leurs temps de lecture ; elles avaient comme unité métrique et spatiale le mot et le lien orthographique, et comme forme contenant l’espace ou le temps graphique, ce dernier n’étant pas rédigé de manière mécanique ou simplement visuelle, mais présupposé dans la scansion, et agissant dans l’écriture et dans la pensée.
J’interrompais le poème quand était épuisée la force psychique et la significativité qui me poussait à écrire ; c’est-à-dire l’idée ou l’expérience ou le souvenir ou la fantaisie qui remuaient le sens et l’espace. Je distribuais aux espaces vides entre les sections du poème le temps écoulé ou l’espace parcouru mentalement par les conclusions logiques et associatives à tirer puis à ajouter à n’importe quelle partie du poème. Et en fait l’idée était logique ; mais l’espace n’était pas infini, bien que préétabli, comme s’il compromettait l’idée ou l’expérience ou le souvenir, en transformant mes syllabes et mes timbres (éparpillés à travers le poème, à la façon de rimes non rythmiques) en associations denses et subtiles ; le sentiment revécu momentanément s’affermissait à travers quelques rythmes fixes. Parfois, rarement, le rythme fixe prédominait et obsédait, et à la fin je voulus retrouver aussi la parfaite régularité rythmique de ce sentiment, et ne le pouvant pas, je fermai le livre à son unique tentative d’ordonnement abstrait, c’est-à-dire à l’ultime poésie.
En écrivant à la main plutôt qu’à la machine je ne pouvais pas, comme je m’en aperçus immédiatement, fixer d’espaces parfaits et des longueurs de vers en formules parfaitement égales, ayant l’idée ou le mot ou le lien orthographique comme unité fonctionnelle et graphique, sauf à vouloir écrire sur du papier à carreaux d’écolier. En écrivant à la main normalement, je pouvais seulement tenter de comprendre instinctivement l’espace-temps préétabli dans la formulation du premier vers, et peut-être plus tard et artificiellement, réduire la tentative à une de ses formes approximatives, retranscrite par une impression mécanique. Et puis en écrivant à la main, on pense plus lentement ; la pensée doit attendre la main et s’interrompt ; le vers libre a plus de sens puisqu’il reflète ces interruptions, et cet isolement du mot et de la phrase. Mais en écrivant à la machine je peux quelques instants suivre une pensée peut-être plus rapide que la lumière. En écrivant à la main peut-être je devrais écrire de la prose, pour ne pas revenir à des formes libres : la prose est peut-être en fait la plus réelle de toutes les formes, et ne prétend pas définir les formes.
Mais retenter l’équilibre du sonnet du Quatorzième siècle est également un idéal réel. La réalité est si lourde que la main se fatigue, et aucune forme ne peut la contenir. La mémoire court alors aux plus fantastiques entreprises (espaces vers rimes temps).
1962
(1964)