Nous étions l’espèce humaine. La plupart d’entre nous étions contraints de vivre une routine qui rythmait la vie de certains, d’autres se suicidaient pour y échapper. Des êtres qui semblaient nous dépasser par l’argent sombraient eux aussi dans les mers du cauchemar. Nous en étions là : nous ne savions plus s’il fallait être heureux ou non. Le bonheur disparaissaît aussi vite qu’il arrivait.
Nous n’avions que dix-huit ans quand la routine nous a touchée, comme nos parents, nos arrières grands-parents. Elle était inévitable, infaillible. Alors que nous venions à peine d’atteindre la fleur de notre majorité, celle-ci s’envolait aussi vite. Nous étions adultes. Nous pensions qu’il ne s’agissait que de pouvoir, boire une bière sans qu’on puisse nous dire quoi que ce soit. Mais c’était en réalité beaucoup plus profond. Voilà alors qu’à la fleur de cet âge, à l’obtention de notre première année et à notre dernier été, un été chaud, insupportable sous des tubes d’été qui se répétaient encore et encore, nous prenions la route des études : une porte se fermait derrière nous et une nouvelle s’ouvrait. Nous n’étions plus des enfants. Nous étions en train d’entendre la condamnation de notre propre vie dans un mode appelé : métro, boulot, dodo.
Elle commençait, cette vie, par un réveil parfois agréable, parfois moins. Nous devions nous lever en oubliant déjà notre vie d’hier et penser au jour nouveau. Nous nous frottions les yeux, nous pensions à nos rêves lointains, à la journée qui arrivait : allait-elle être bonne ? Nous quittions le lit chaud, d’un air désespéré en regardant la pluie qui retentissait sur la fenêtre. Nous n’aimions pas l’affronter, nous aimions seulement l’écouter. Le froid prenait alors possession de notre corps après l’abandon du confort. La garde-robe, mal rangée, où les vêtements nous suppliaient presque de les laisser au chaud. Le choix. La porte de la chambre se fermait.
L’énorme couloir qui se confrontait à nous était comme une ouverture vers notre propre vie, il fallait déterminer quelle porte nous allions emprunter pour continuer le reste de notre journée. Une porte et un couloir n’étaient que de simples parties d’une maison, avec des matériaux, riches ou pauvres. À première vue ce n’était que cela. Mais en réalité ils étaient les chemins de nos vies. Le choix que nous faisions par le biais de ce couloir définissait notre personnalité, notre humeur, notre éducation et tout simplement cette routine qui grouillait en nous plus que jamais.
La porte de la salle de bain s’ouvrait. Déjà nos sens s’éveillaient à l’entrée de la pièce. L’odorat convoquait les doux et délicieux parfums du shampoing et du gel douche, du parfum fort de nos pères encore tout récent. L’ouïe, par le bruit résonnant de la douche, du robinet et de l’eau gelée qui coulait contre la brosse à dents, contre la peau, le bruit du frottement infini car maman nous répétait « il faut que ça brille ». Son lisseur qui claquait à chaque nouvelle mèche, tout comme les barrettes dans nos cheveux. Le toucher, de nos cheveux que l’on brossait, qui tombaient, nos mains qui atteignaient les différentes parties de notre corps, ce corps qui changeait petit à petit, que nous ne nous connaissions pas vraiment, que nous apprenions à connaître de plus en plus à chaque fois que nous passions cette porte. Nous touchions la matière de nos vêtements, nous passions de notre peau à la soie, la laine, le cachemire, le polyester, le coton, le lin qui allaient bientôt faire partie de nous. Le goût, par le petit déjeuner qu’on prenait à la va-vite, le café qu’on buvait sans avoir le temps de l’apprécier, un goût amer que nous ramenions souvent à notre propre personne, ou un goût au contraire trop sucrée, des personnes trop tristes, des personnes trop joyeuses. Le goût de la vie. La vue. La vue de notre reflet dans le miroir. C’était la plus grande partie du voyage. Nous étions confrontés à nous-mêmes pour la première fois de la journée. Mais pas la dernière. Nous regardions alors l’état de ce qu’avait pu être notre nuit, bonne, mauvaise, moyenne. Nous étions abandonnés à notre reflet, il nous regardait lui aussi d’un air presque moqueur et nous cherchions comment effacer ce sourire triste, ces sourires que les autres nous adressaient également. Alors, nous faisions en sorte de choisir des tenues adaptées, en portant attention à l’accord des couleurs, pas trop fade, pas trop coloré, mais quand même, pas trop normal, pas trop bizarre. Alors, il était temps de ne plus être nous-mêmes. Nous cherchions à nous modifier, par le biais du maquillage : la poudre qui faisait éternuer, le mascara qui faisait pleurer, le rouge à lèvre qui séduisait. Le but était d’être tout, sauf de laisser le vrai nous montrer au reste du monde. Nous avions appris à nous habituer. Nous n’étions qu’une brève copie d’un nous, un « nous » meilleur, plus beau, plus souriant, un nous qui était tout sauf nous. Alors, sur un morceau de Depeche Mode, nous nous plaisions à enfin devenir quelqu’un d’autre.
La société ne nous donnait pas le choix. Nous étions ses pantins, nous faisions exactement ce qu’elle voulait que l’on fasse : lui ressembler. C’était comme ça que les filles, de plus en plus tôt se complexaient pour n’importe quoi, que nous pleurions le soir en nous comparant à celles que l’on appelait « perfection » sans vraiment donner un sens réel à ce mot. Nous pensions qu’il fallait être comme ça, comme les filles des publicités sans avoir la moindre idée que tout était faux. Nous nous confondions dans une réalité faussée, les garçons fantasmaient sur les magazines et nous voulions nous aussi avoir notre moment de gloire, pensant que c’était l’objectif ultime d’une vie, sans nous douter de ce qui suivait, sans savoir qu’en réalité, nous devions être la seule et unique personne que nous étions depuis toujours : l’être humain avec l’âme sensible. L’amour ne se résumait parfois qu’aux mots, pas au corps, on faisait parler le corps par les mots. Nous voulions trouver notre Verlaine, en nous aidant de la superficialité de la société, sans nous douter que nous n’y étions pas encore.
Nous descendions à vive allure avec nos chaussures à la main, le manteau, l’écharpe afin de les enfiler au plus vite : nous ne devions pas être en retard pour aller à l’Université. Bien que nous frôlions plusieurs fois de déroger à cette règle. Nous prenions le petit déjeuner dans le sac, voire le déjeuner, nous étions chargés dans nos cœurs et nos esprits. Maman qui nous disait de nous dépêcher et la porte de la maison se refermait. La maison était le symbole de toute une vie. Elle renfermait l’odeur du chocolat chaud le matin quand nous étions petits, les anniversaires, les disputes, les chagrins, les bonnes nouvelles, les secrets, l’amour. Nous n’étions pas tous étudiants indépendants et certains d’entre nous étaient encore chez leurs parents. Lorsque nous quittions le domicile familial pour partir vers notre vie plus professionnelle, nous quittions non pas seulement nos parents mais également notre confort, notre aisance, nos laisser-aller et nos souvenirs. Une fois dehors, nous n’étions plus l’enfant de nos parents, nous n’avions plus cette sorte de pouvoir dans cet espace où nous pouvions faire ce que nous voulions, sans gêne, sans risque. Nous changions de visage à la sortie de notre maison. Nous devions faire preuve de ce que l’on appelait l’éducation.
Le rapport intime commençait. Il y avait entre maman et nous une sorte d’alchimie inexplicable, le genre de relation où l’on ne pouvait poser des mots que quand nous l’avions vécue. Elle nous demandait si nous n’avions rien oublié, toujours dans le même ordre : cours, carte, déjeuner, argent. Cette énumération nous rappelait à la fois une certaine nostalgie mais également comment fonctionnait la vie, de quoi elle était faite. Dans une oreille, Making plans for Nigel de XTC, un air blasé. Nous voulions tous être comme elle. Les trajets étaient toujours différents : un jour nous ne parlions pas et un autre nous n’avions pas assez de la route pour tout nous dire. Nous avions des avis très différents, ce qui nous donnait la cause principale de nos disputes mais aussi de notre amour. Des potins, les infos de la radio relayant encore et encore la politique, la mauvaise humeur, la bonne humeur, les chants, les énervements : voilà le résumé de notre courte balade. Avec notre père, c’était différent, nous étions plus distante, il n’y avait pourtant pas un manque d’amour mais juste une certaine pudeur. Il y avait le silence du respect, de l’amour paternel et protecteur. Ces moments-là aussi étaient agréables. Mais c’était notre maman qui nous guidait par la main vers la vie adulte en partageant cet instant, avec la crainte tous les matins, qu’il pouvait nous arriver quelque chose, que peut-être nous n’allions pas nous en sortir mais elle chassait cette idée en secouant la tête : « Ça va aller » disait-elle. Nous étions à la gare, une dernière vérification et nous étions déjà dehors, par peur du temps. La porte de la voiture se refermait.
L’entrée de la gare paraissait à première vue assez banale, une gare comme il y en a partout dans tous les coins de la France. Mais chaque gare représentait beaucoup plus chacun d’entre nous. Nous la connaissions par cœur. C’était comme un labyrinthe magique où nous devions trouver notre chemin pour voyager. Elle ressemblait à un grand théâtre, un théâtre d’émotions, de passions, de tragédies : il y avait des acteurs plein la gare, dont nous, nous étions tous à la fois comédiens ou tragédiens d’une certaine façon, nous animions le spectacle de notre vie. Nous traversions la porte du sous-terrain, un repère hors du temps, où la lumière naturelle cessait, où la noirceur de nos cœurs s’ouvrait. Nous étions ces personnes pressées qui couraient après la vie et le temps, nous pleurions sur le quai au départ de quelqu’un de cher et abandonnions derrière nous des précieux souvenirs, des moments partagés autour d’un café ou une balade à vélo, nous échangions des baisers, des étreintes dignes d’un adieu et nous retournions à nos vies, laissant la tristesse de côté. Nous devenions cette mélancolie de la routine, celle de nous-même, celle des autres. Nous étions les autres, tous là dans un même but, tous liés dans un avenir proche. Nous attendions dans un froid glacial, nos têtes étaient rentrées dans nos écharpes, nous réchauffions nos mains en les frottant, en soufflant notre air chaud dedans. Par impatience nous rallions, nous soufflions, les hommes devenaient désagréables, c’était ainsi que nous étions. Nous étions des acteurs avec différents rôles mais nous étions tous essentiels pour continuer notre chemin. Le train arrivait et là, l’excitation générale montait, les mouvements étaient plus précipités, nous étions impatients, impatients de retrouver un confort et une chaleur pour remplir nos cœurs. Il était bientôt là, nous nous rapprochions tous un peu plus de la bordure du quai, nous étions comme effrayés de rater ce qui pourtant allait être devant nous dans quelques secondes, peur de ne pas avoir notre confort pendant le voyage. Nous le regardions tous arriver, il freinait, puis, nous devinions petit à petit quelle porte nous allions prendre et nous bougions en fonction d’elle. La foule dispersée que nous étions prenait forme jusqu’à ce que nous formions une troupe. Nous étions prêts à rentrer en scène.
Le bouton du train clignotait d’un vert vif, la scène s’ouvrait enfin, chacun pouvait prendre place. Nous nous serrions à l’entrée, nous nous pressions d’être les premiers arrivés, le train résumait l’être humain : nous étions des êtres enragés, prêts à marcher sur nos voisins, égoïstes, nous avions fait disparaître ce que nous appelions autrefois la solidarité. Et voilà comment nous, les acteurs, devenions en une fraction de secondes des animaux comme si c’était là notre rôle. Nous nous asseyions là où nous pouvions, fatigués de l’effort que nous venions de faire, assez honteux d’avoir réagi d’une telle manière. Le train commençait à gronder, à fermer définitivement ses portes, le rideau se fermait et le voyage pouvait démarrer. Nous nous amusions à nous observer, discrètement, dans le train. Nous étions tous si proches les uns des autres sans pour autant nous connaître que cela nous fascinait, nous tenions une proximité intime avec des inconnus que nous ne recroiserions jamais. Nous sentions la chaleur de l’autre, l’humeur, le but, le caractère. Certains d’entre nous étaient essoufflés avec des perles d’eau qui jaillissaient sur leur front, c’était comme si nous ne pouvions jamais retrouver l’air dont nous avions besoin, c’était même à se demander s’il y en avait encore. D’autres sortaient un livre, nous aimions ces gens-là, nous aimions nous référer à quel genre de livre nous lisions pour nous découvrir. Un livre qui s’ouvrait n’était pas seulement un morceau de papier qui était orné de lettres et de mots sous forme d’un roman, d’une poésie, d’un essai, ou d’une nouvelle : le livre ouvrait également l’âme de notre personne : ce que nous aimions, de quoi nous nous inspirions. Nous étions aussi plongés dans nos pensées, un morceau dans nos oreilles Love on a real train de Tangerine Dream, et la musique nous soignait, elle soignait nos cœurs meurtris de douleurs intenses, les douleurs de la vie, elle était comme une drogue, une drogue incroyable qui nous faisait sentir autre que nous-mêmes, mieux qu’une drogue, à l’instar du LSD, elle nous donnait le droit d’accéder à notre imagination la plus profonde, la plus intense, la plus hallucinante : nos pensées dérivaient, nous nous imaginions tour à tour star de cinéma en pleine scène dramatique, dans un festival de musique ou sur une plage au soleil. La musique allumait nos vibrations. Le son était si fort que nous entendions même la musique de nos voisins, nos âmes parlaient, elles communiquaient, nous vivions. Le voyage n’était pas solitaire, il était partagé avec le reste de ce qu’on appelait le monde à ce moment précis. Nous étions aussi en train d’écrire, à la main ou nous tapotions à l’ordinateur nos idées farfelues pour un devoir. La liberté se ressentait. Avec une volonté, une rage, un plaisir. Nous tapions alors, encore et encore, les virgules se marquaient, les points se formaient, les pages défilaient et nous sortions enfin de nous-mêmes, nous étions libres, l’espace de quelques mots, le monde était à nous. Nous étions en train de déguster nos repas, à midi, le sandwich jambon-fromage de notre mère qui avait une forte odeur de mayonnaise, nous mangions dans l’espace qui nous était donné, pas de table, pas de couverts. Nous étions endormis sur nos sièges, nous combattions la fatigue, nous étions parfois levés depuis l’aube alors nos corps se relâchaient le temps du voyage, nous goûtions à la tranquillité avant de repartir dans nos vies plus fades. Les arrêts défilaient tels les actes de la pièce, les paysages se succédaient, nous regardions passer devant nos yeux des villes, différentes mais avec une certaine ressemblance frappante. Le ciel était bleu, un bleu que nous ne pouvions pas définir, un bleu qui se mélangeait au blanc, le blanc de la neige. Les paysages étaient dignes d’un tableau ou d’une description de Zola, les petites maisons de briques assemblées les unes aux autres avec ses habitants qui devaient, sûrement, supporter le bruit du train qui passait tous les jours. Les forêts immenses, les champs des agriculteurs à perte de vue, les buissons, les petites gares : c’était ainsi que nous voyions les villes de Rosult ou encore Orchies. Le voyage était beau. Nous respirions un bon-esprit général au sein de notre troupe et nous nous évadions chacun à notre façon. Puis nous arrivions au terminus du train, « Gare Lille Flandres ». Le décor avait changé considérablement : nous observions à présent des bâtiments industriels, des buildings, tout était gris et commercial, adieu notre verdure et nos petits pâturages où nous rêvions dix-minutes plus tôt. Nous disions adieu à notre liberté, notre rêverie resterait ici, dans ce train, nous clôturions le dernier acte, et nous retournions à notre vie.
La porte du train s’ouvrait, elle nous laissait nous séparer de l’autre « nous » que nous avions été le temps d’un instant. Nous redevenions pressés, nous ne voulions pas arriver en retard au travail, à l’université ou au rendez-vous avec nos amis. Nous marchions vite, la troupe avait éclaté et nous nous dispersions telle une fourmilière d’inconnus, nous disions adieu aux autres nous que nous ne reverrions jamais. Nous traversions les autres tels des obstacles, nous bougions avec une agilité incroyable pour arriver jusqu’aux escaliers qui menaient dans un nouveau monde encore. Une nouvelle porte qui séparait les départs des trains et la gare même apparaissait. Dans cette gare, qui était entourée de ses petites boutiques, nous ne voyions plus aucun chemin de fer, nous n’entendions plus le bruit du sifflet que le contrôleur donnait pour annoncer le départ ni les roues qui grinçaient contre les rails. Nous observions ici, de nouveau, des personnes comme nous, qui étaient impatientes et regardaient désespérément l’écran qui affichait l’heure, le retard ou le quai du train. Nous passions à travers ces personnes, et nous trouvions ces fameux escaliers qui nous faisaient descendre encore un peu plus bas. Oui, nous descendions vers un nouveau labyrinthe de la vie, la fourmilière que nous étions avait refait son apparition au point où nous ne faisions plus attention aux mendiants par terre qui attendaient la pitié des gens. Nous nous disions à ce moment-là que nous avions de la chance et nous avancions d’un pas décidé vers ce qu’on appelait le « hall » du métro. Nous voyions du monde de tous les côtés. Nous préparions notre carte et nous la passions sur le portique de sécurité qui ne s’entrouvrait que quelques secondes. Nous traversions une nouvelle porte mais celle-ci était limitée dans le temps, c’était une porte qui nous attendait, qui nous poussait à aller vers le devant pour que nous ne manquions pas le temps qui passait. Nous marchions alors une nouvelle fois, tout droit, la fourmilière se séparait, elle prenait des chemins différents, et ils étaient indiqués par différents panneaux d’instructions, de noms de ville, nous avions des objectifs différents pour le reste de notre voyage. Nous nous dirigions alors tout au fond à droite, là où nous allions poursuivre le reste de notre voyage. « Direction 4 Cantons – Stade Pierre-Mauroy », nous descendions encore plus bas, et nous fixions l’arrêt où nous allions nous arrêter. Nous nous frayions ainsi une place et attendions cette technologie qui permettait de nous emmener chez nous, au travail ou à l’université de plus en plus vite, nous attendions ce nouveau voyage avec impatience. Il était bientôt là. Et nous ressentions, comme une sorte de « déjà-vu » cette impatience et cette frénésie autour de nous semblable à celle qu’il y avait pour le train.
La porte du métro s’ouvrait. Nous attendions notre tour pour y rentrer, il y avait déjà une autre masse importante qui sortait, qui était elle aussi pressée d’arriver à destination. Nous rentrions enfin dans cet appareil, il y avait dedans une lumière artificielle assez blanche et le reste du métro était d’une couleur verte, un vert que nous ne pouvions décrire. Nous nous tassions le plus possible et les portes se refermaient. Il y en avait deux, celle qui faisait partie du métro et une autre, une porte de sécurité : nous nous coincions parfois dans cette porte, qui heureusement ne nous coupait pas en deux, mais nous laissait passer. Un bruit retentissait comme pour nous donner l’alarme. Nous étions là, adossés à ces fameuses portes et nous tenions la barre tant bien que mal pour éviter de tomber. Le métro démarrait, voilà que tout ça recommençait à nouveau. D’abord, nous sentions un transport assez lent, puis il accélérait, plus vite que jamais il grondait dans sa course et tremblait tel un tremblement de terre. Il arrivait que nous croisions un autre métro et nous ressentions ce double-voyage, une double-évasion durant une fraction de secondes. Lorsque nous étions au-devant de l’appareil, un paysage fascinant et effrayant s’offrait à nous : nous nous enfoncions dans une immense bouche sombre, noire, sans plus finir, sans savoir si nous allions en sortir un jour. Nous étions entourés d’autres nous une fois de plus mais avec une promiscuité plus certaine. Il y avait une gêne qui se dressait dans nos yeux lorsque nous croisions nos regards ou que nous étions pris la main dans le sac quand nous observions quelqu’un. Dans le métro, nous ne pouvions pas être comme chez nous, il y avait en nous cette retenue, nous ne devions pas parler trop fort sinon nous ne semblions pas « normaux ». La normalité nous envahissait, nous avions peur de ne pas être comme les autres, nous jugions trop facilement. Nous assistions à la scène d’un appareil à la vitesse incroyable qui s’enfonçait de plus en plus dans le gouffre et accompagnait ses voyageurs, tous étant plus pudiques les uns que les autres. Nous dormions, nous lisions debout, nous étions une fois de plus dans nos pensées, nous attendions avec impatience, nous pouvions nous lire dans l’autre, car nous étions aussi passé par ces différents sentiments. Chaque fois que la porte s’ouvrait de nouveau, nous emmenions d’autres « nous » dans notre voyage. C’était de loin un endroit fascinant, où les origines, les cultures, les personnalités se mélangeaient le temps d’un instant, nous étions comme dans un nouveau pays, une culture infaillible, un moment de partage dont nous ne nous rendions pas forcément compte car nous étions trop aveuglés par nos pensées, nos vies, le futur proche qui nous attendait. Le temps s’écoulait, les dernières notes deKisetsu wa Tsugitsugi Shindeiku du groupe Amazarashi, se terminaient lentement, nous plongeaient dans une culture parmi tant d’autres dans cet espace, c’était la culture japonaise que nous aimions tant, et nous nous demandions comment était le métro au Japon, comment ils vivaient leur voyage quotidien. Puis nous ne nous étions pas rendus compte que le voyage était déjà terminé, il était plus court que le train et l’évasion de courte durée nous ramenait maintenant à la réalité, au terme de notre voyage. La porte du métro s’ouvrait et nous sortions, des rêves plein la tête, nous retournions à notre propre culture, notre personnalité.
Mais nous n’oublions aucun de ces voyages.
« Pont de bois » annonçait la voix féminine qui était utilisée pour le métro. C’était notre destination. De nouveau, il y avait un escalator, différent de l’autre. Nous étions réunis entre étudiants, nous nous dirigions tous vers un même but et nous nous rappelions que ce moment était semblable à celui du train. Nous étions la jeunesse incarnée, le signe de la liberté, « on n’est pas sérieux quand on a 17 ans » disait Rimbaud. Et au-delà de la jeunesse se confondaient des personnes de tout âge, des bonnes femmes, des professeurs ou des étudiants juste plus âgés. Nous arrivions en haut, nous remontions à la surface, à la lumière naturelle, l’odeur des croissants de la petite boulangerie dans le hall traversait nos sens, c’était l’odeur de la nostalgie, de l’amour, de l’espoir. Nous remettions nos écouteurs, Relax de Frankie Goes To Hollywood résonnait dans nos oreilles, nous traversions le hall du métro et poussions la porte et nous nous délivrions au grand jour, nous tenions la porte pour notre voisin de derrière comme si nous lui disions « bon courage » à lui aussi, qui allait accomplir son destin. Nous partions sans vraiment fermer cette porte de nous-mêmes, sachant pertinemment que nous la retrouverions plus tard.
Nous marchions tous dans la même direction avec une certaine distance entre nous, parmi la verdure et le macadam, le soleil faisait chauffer le cuir de nos blousons, nous entendions les cris des enfants qui jouaient dans l’école d’à côté. Les bus s’arrêtaient aux arrêts et crachaient leur fumée, nous croisions pour la troisième fois l’impatience et la précipitation de l’espèce humaine mais nous n’en faisions plus partie, nous les esquivions car notre chemin se raccourcissait de plus en plus. Il y avait des plaques de verglas au sol, nous étions prudents et nous marchions doucement, quand certains d’entre nous tombaient, nous ressentions ces deux sentiments si proches mais à la fois contraires : le rire et la pitié. Nous voyions alors le pont qui se dressait sous notre vue avec une flèche puis une vieille indication, comme oubliée là : « Université de Lille 3 ». Nous y étions. Après nos longs voyages, nous y arrivions. Nous montions l’escalier, traversions le pont qui se trouvait au-dessus d’une route, nous admirions la vitesse des voitures, sur notre peau il y avait à la fois soleil et ombre, et nous finissions par regarder devant nous. Nous devenions petits face aux bâtiments de l’université, la grande bibliothèque qui se dressait devant nous, l’immensité de l’espace libre, le nombre impressionnant d’étudiants qui sortaient et rentraient : nous nous rappelions que nous n’étions qu’un petit humain parmi des milliards dans un univers immense.
Il n’y avait pas de porte à proprement parler, c’était une ouverture imaginaire et cela nous faisait penser au principe de ce qu’était « la fac ». Loin de nos grilles de lycée où nous avions besoin d’une autorisation pour rentrer, nous étions ici dans un endroit ouvert à tout le monde, peu importe comment nous étions, il n’y avait pas ici de regards jugeant, nous rentrions dans le monde de nos études et sortions de la société à laquelle nous avions dû faire face plus tôt. L’odeur de nourriture qui provenait du restaurant universitaire nous montait à la tête et aux narines. La cigarette marquait la dernière ligne droite avant de pénétrer dans le bâtiment où se donnait notre cours. Nous glissions la main dans nos paquets, prenions l’une des dernières cigarettes et soupirions du faible nombre qu’il restait, d’une autre main nous attrapions nos briquets, nous l’allumions et faisions sentir la chaleur de la flamme contre notre main. Nous nous détendions. Nous nous rappelions encore que nous avions la chance d’étudier car nous lisions tous les jours le scandale pour les frais d’inscription qui concernaient les étrangers. Qu’en serait-il bientôt ? Nous avancions de plus en plus vers le Bâtiment A, il y avait là une nouvelle troupe, une troupe de fumeurs qui attendaient près des cendriers, le temps d’une pause. Nous écrasions la nôtre déjà terminée par nos consumations excessives et la porte de l’université s’ouvrait, nous y étions, pour de bon.
La porte était électrique mais restait en permanence ouverte. Nous claquions nos chaussures contre le carrelage qui habillait tout l’énorme bâtiment dans lequel nous étions. Le bâtiment ressemblait lui aussi à un labyrinthe sans fin aux mille possibilités, avec des pancartes qui indiquaient les étages, les salles, les amphithéâtres et d’autres encore. Nous regardions notre téléphone pour vérifier nos cours et l’heure passant, nous pressions le pas, traversions les autres personnes présentes dans ces grands couloirs que nous bousculions parfois sans le vouloir. Nous descendions vers le sous-sol, nous retrouvions une lumière artificielle semblable à celle du métro, nous lisions au passage d’un coup d’œil les affiches qui étaient présentes face aux escaliers et nous nous retrouvions très vite dans un endroit semblable à celui du dessus que nous venions de voir. Nous prenions le temps de nous arrêter à une des nombreuses machines qui résidaient dans ces couloirs que nous parcourions. Plus que quelques minutes et nous allions être projetés de nouveau dans un autre monde. Nous lisions sur les panneaux : « Département Lettres Modernes » et nous tournions finalement à droite dans un petit couloir où se trouvaient l’évasion, la délivrance de la routine, loin des transports en commun, de la technologie, des normes de la société. Nous respirions de plus en plus fort et transpirions par crainte de ne pas arriver à temps. A1.760. La porte était déjà ouverte. Nos cœurs et nos esprits aussi. Nous adressions la formule de politesse à notre professeur, tapions un claquement de joue à nos amis. Nous nous munissions de nos outils pour commencer la grande expédition vers un autre nous. Nous étions enfin nous-même, la page du livre était bloquée dans nos mains, nous n’attendions plus que le signal du professeur qui annonçait le thème du jour qui mêlait originalité, intelligence et immersion imminente. Nous étions tous prêts, le souffle court, nous n’entendions plus que nos cœurs qui battaient, nos âmes s’entrechoquaient dans cet élan de préparation. Notre professeur fermait enfin la porte. Le véritable voyage pouvait commencer et nous n’étions, après toutes ces différentes expériences avec autrui, avec nous-même, face au monde, à la société, mais nous ne nous doutions pas qu’en réalité, nous n’étions qu’au début de la grande expédition.
*
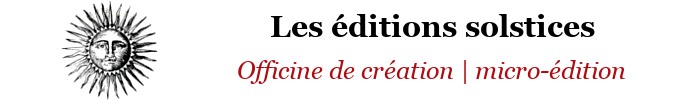
Écriture dynamique qui nous permet d’être en même temps que l’écrivaine dans le feu de l’action.
J’ai beaucoup aimé et j’encourage Josepha à continuer d’écrire.