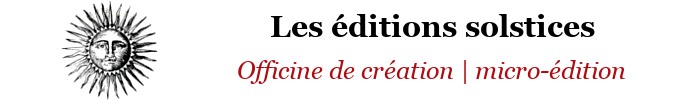Qu’il est parfois difficile de se souvenir. Laisser venir à soi quelques fragments d’un périple, les penser, les contempler… Pourquoi me restent-ils ? Certaines choses demeurent comme une marque au fer rouge, et d’autres s’estompent à la manière des lettres qui fanent sur un vétuste feuillet. Ce n’est qu’en plissant les yeux, en essayant de déchiffrer que l’on peut s’émerveiller de la beauté du souvenir. Des bribes reviennent, surgissent, ou se montrent avec pudeur à notre âme, à notre cœur.
Et je comprends aujourd’hui ô combien il est bon de se souvenir, de revivre les voyages passés, les voyages de l’enfance qui nous ont façonnés.
Il y avait comme cela des moments de rien, mais qui demeurent grâce à l’ennui, comme cet après-midi-là, au bord de cette rivière qui court au pied du Moyen Atlas. Maman faisait une sieste sur un rocher de la berge, et moi j’avais cueilli des feuilles de saule quelques mètres en amont. Comme souvent, je m’étais entendue avec la solitude, et ces feuilles, dans mon imaginaire, étaient de petits êtres éphémères que je pouvais faire vivre à ma guise. La transpiration de mes mains couplée à la chaleur et à l’humidité privait bien vite ces feuilles de leur éclat. La première s’était déchirée au creux de ma paume. Scène tragique dans un esprit d’enfant, il lui fallait une sépulture. C’est donc après cette mort symbolique que je m’étais postée au bord de l’eau pour y déposer à la surface, le petit corps végétal. La seconde feuille disait adieu à la première, et finissait toujours par la suivre dans une longue procession…
Il y eut dans ce rituel quelque chose d’inéluctable, quelque chose qui sur le reflet de l’eau me définissait l’éternité.
Je ne connaissais pas le fleuve des enfers, ni même le film Cimetière dans la falaise dans lequel on retrouve ce même geste ; et pourtant, il est drôle de penser que je venais de comprendre que la rivière elle-même, à l’instar de la mort, était l’image de la vie.
C’est à Marrakech que ce voyage avait commencé. Riad Al Jazira, rue Ben Slimane, au cœur de la médina, c’est là que nous dormions. Je m’en souviens encore. Ce lieu était grandiose. Pour y parvenir, il fallait s’adonner au jeu labyrinthique des ruelles. Une porte en bois cloutée nous apparut alors, c’était l’entrée du Riad. Héritier des contes orientaux, il nourrissait les fantasmes avec son architecture mozarabe, ces arbres à l’intérieur qui défiaient les colonnes et son atrium central où les pétales épousaient la surface de l’eau. Des frissons comme des aiguilles avaient gagné mon corps lorsque j’avais voulu tremper mon pied dans le bassin. Ce fut la première fois que mon goût pour l’eau se résignait à cause de sa température.
De notre chambre, on entendait le muezzin qui appelait à la prière. Celle-ci donnait sur l’un des patios, là ou la lumière transperce élégamment les moucharabiehs. Tout était blanc, sauf les coussins, fuchsia, finis au fil d’or, et le sol en terre cuite. Nous prenions le petit déjeuner à même le sol, sur ces coussins, autour de l’atrium, et il avait parfois quelques moineaux qui s’invitaient au festin.
Il y avait tout près, au coin de la ruelle, un tabac aux airs de bicoque que maman fréquentait à toute heure pour y acheter ses cigarettes. Un peu plus loin c’était une école, on y voyait, chaque jour, sortir des élèves qui devaient avoir mon âge. Je me souviens des regards curieux et discrets qu’on avait pu échanger. Ce fut pendant ces premiers jours que je m’étais sentie séduisante. C’était une situation tout à fait inédite pour moi, un peu garçonne et rondelette, qui percevais dans mon dos les yeux intrigués des garçons.
Le premier jour, un guide officiel s’était présenté devant nous, proposant de faire une visite du coin. Bien sûr, c’était un faux, mais grâce à lui, nous avions pu voir des choses que jamais nous n’aurions tentées. Il nous avait fait rentrer dans une habitation et nous avait présenté à un de ses amis. J’ai oublié son prénom. C’était celui qui faisait le pain du quartier. Sa maison était sombre et minuscule, elle possédait un énorme four qui sentait bon. L’ami, enthousiaste, nous avait alors montré comment il fabriquait son pain. Je me réjouissais qu’on me fasse si bon accueil. Cette rencontre fit surgir un sentiment de bonheur, qui survient encore parfois lors de moments de partage.
Il y avait également eu les insultes que maman avait pu subir, lorsque qu’elle ne donnait pas, ou pas assez d’argent à celui qui lui avait indiqué le chemin qu’elle cherchait. C’est la première fois, je crois, que j’ai connu la pauvreté, la vraie.
Je me souviens de la médina de Marrakech et de ses souks comme une sorte de shoot. La foule, les couleurs, les odeurs saturaient mes sens. Notre attention portée aux choses valsait avec la frénésie des lieux. Je me souviens des innombrables marchands d’épices et de tissus, je me souviens des pattes de moutons qui pendaient au dessus de nos têtes, je me souviens des tanneries, des teintureries, de la pestilence, des ocres et des teintes solaires, du monsieur qui tournait le bois avec ses pieds, des caméléons qui se vendaient au marché noir. Je me souviens avoir voulu en ramener un en France. Je me souviens que c’est dans les souks que j’ai fait la première négociation de ma vie. J’avais réussi à obtenir un pendentif en argent à bon prix, j’en étais fière et je l’avais gardé sur moi encore longtemps après notre retour. Je me souviens être rentrée avec maman dans une teinturerie qui vendait aussi quelques foulards. L’homme avait proposé de nous voiler à la manière traditionnelle, juste pour voir. Maman avait accepté ; et ce qui ne nous fait plus rire aujourd’hui, nous avait fait rire à l’époque.
À la sortie du souk, à l’entrée de la place Jemaa El-Fna, nous avions croisé deux jeunes femmes dans la foule. Je les avais repérées car elles semblaient à la fois duelles et complices. J’aurais pu me souvenir que l’une était vêtue de blanc et l’autre de noir, l’une aurait pu être immense et l’autre minuscule, l’une aurait pu avoir la taille d’un sablier et l’autre une belle forme de poire ; seulement ce qui m’avait frappé tout de suite, c’est que l’une portait un mini-short et des lunettes hollywoodiennes alors que l’autre, plus prude, portait un voile bleu nuit jusqu’en bas des épaules. Pourtant ces deux femmes riaient aux éclats dans ces lieux de contradictions, imposant ainsi leur droit d’exister. À cet instant, ces deux entités formaient un équilibre parfait. L’une est-elle une figure moderne et l’autre archaïque ou bien sont-elles des icônes de la décadence et de la pureté ? Qui suis-je aujourd’hui pour en juger, moi, avec mon regard occidental ? J’ai toujours pensé que notre liberté passe par l’expression de soi. En tant que femme, je ne peux m’empêcher de percevoir l’image du voile comme une entrave. Je ne mesure pas mon ignorance et tout cela me questionne.
Je me rends compte aujourd’hui que ces souvenirs sont exactement comme les dédales du souk, ils nous obligent à quelques détours. Pour voir, il faut accepter de se perdre. Le grand minaret qui nous servait de point de repère, ça, je l’avais oublié. J’avais oublié les murs de la médina, rouges et parsemées de trous, ces murs lourds et compactes dans lesquels les cigognes viennent faire leur nid chaque année. J’avais oublié les motos qui mettaient la foule en émoi, j’avais oublié tous les apothicaires et leurs produits miracles : racine qui fait grossir/racine qui fait maigrir, j’avais oublié l’étroitesse des rues si bien que le soleil ne pouvait y pénétrer qu’une heure dans la journée, j’avais oublié les vendeurs de cuivre et de fer blanc, j’avais oublié… J’avais oublié qu’un souvenir est un bout de laine qui dépasse d’une vieille écharpe, on le tire et puis elle se détricote.
Je me souviens en revanche des jus d’oranges de la place Jemaa El-Fna ; ils restent pour l’heure, les meilleurs de ma vie. L’odeur des fruits se mêlait subtilement au goût des pâtisseries faites de miel et d’amandes. Et le soir, l’évanescence de ces parfums laissait place à la fumées des grillades et aux épices. Cette place vivait, s’animait selon les heures et les foules. C’était la place de tous les clichés, la place des charmeurs de serpents, des diseuses, du henné, des fossiles… Mais sous l’œil photographique de Maman, elle devenait un lieu fantasmagorique.
La villa Majorelle. Ce qu’on garde de ces lieux, c’est d’abord la sensation de fraîcheur que l’on inspire dans le jardin. Luxuriant, il offrait une balade agréable, presque ennuyante. Maman s’amusait à regarder le nom des plantes qui l’intriguaient. Quant à moi, sans grand attrait pour la botanique, j’observais le microcosme qui se développait dans les jardins. Ma fascination pour la faune et plus particulièrement pour les insectes était comblée. Ici, j’avais trouvé un objet d’étude qui pouvait rivaliser avec le temps.
À l’intérieur de la maison, on avait exposé quelques créations de Saint Laurent, tenues que je trouvais encore trop extravagantes pour la maturité que j’avais, la mode ne m’était encore qu’une idée abstraite.
Mais surtout, ce qui me reste de cette découverte, c’est le bleu de la maison. Un peu comme un bleu berbère, profond et intense à la fois. Je n’ai trouvé que cette couleur capable de réfléchir aussi fort la lumière tout en nous amenant dans notre for intérieur. Un bleu impossible, mais qui existe sous nos yeux. Un bleu qui envahissait la maison, des murs jusqu’aux fleurs.
Ce bleu m’obsède, il ne renvoie pas tant à la mélancolie, il possède plutôt un pouvoir d’évocation, comme s’il arrivait à faire surgir des choses de soi à soi. Je m’étais sentie happée par cette couleur, comme si elle me submergeait plus que je ne la contemplais. Sans doute était-ce la première fois que je sentais l’ivresse.
Entre autres visites, voilà celle qui me revient souvent : Le palais Bahia. À vrai dire je ne me souviens qu’assez peu de l’architecture du palais. Ce qui me reste, c’est qu’on nous avait expliqué que son roi était obèse, et qu’il peinait à monter les marches des escaliers. C’est pourquoi le bâtiment s’étendait sur un seul étage : le rez-de-chaussée.
J’avais posé une délicate question à maman dans un lieu qui ne permettait pas la confusion des mœurs. Je n’en avais pas tout à fait conscience. « Ici, comment ils font les homosexuels ? » Je me souviens de Maman qui m’avait dévisagé très fort. Et comme ce malaise soudain n’avait pas suffit, un guide qui passait non loin avait souhaité que l’on répète notre question. Maman qui tentait désespérément de trouver quelque chose de pertinent, avait finalement demandé s’il avait l’électricité courante dans la majeure partie du Maroc. Je me souviens du regard noir du guide face à l’ignorance improvisée de Maman. Et je me souviens surtout de notre fou rire silencieux après qu’il fut parti.
Nous avions fait un court périple à la mer. Par chance, nous étions venues le jour d’une course de chevaux organisée sur la plage d’Essaouira. Les fusils que nous entendions au loin sonnaient le départ. Hommes et bêtes étaient ornés d’artifices colorés. Les chevaux ne galopaient que sur une distance très courte ce qui donnait à cette course un caractère chorégraphique. Cette parade sur la mer avait presque l’air d’un rêve. J’appris peu de temps après que cette course, la harb dépeignait en fait la charge à cheval et l’exaltation de la guerre, cela en était le retour symbolique.
Maman, elle, était tombée sous le charme du port de la ville. Il abritait une myriade de petites barques bleues, exactement le même que celui de la maison. Elle était restée un long temps pour composer quelques photographies. On avait vu des pêcheurs rentrer et les poissons qui croulaient sur le quai. Il y eut très vite le ballet infernal des mouettes, leur cris moqueurs et leur yeux narquois. Elles tournoyaient comme un essaim, impatientes et cruelles autour du butin.
La nuit sacrée. Pour se rendre à Essaouria, on avait décidé de faire l’aller et le retour dans des transports locaux. Je me souviens alors du goût saumâtre de mes vêtements, de la figure absente des passagers, des djellabas sales et froissées, des paires de mains terreuses, ces belles mains pleines de vie ! Je me souviens du bruit chaotique du bus et de la dureté de ses sièges. La route, unique allait toujours tout droit ou presque. En pitoyable état, elle était parsemées d’interminables travaux. Il n’y avait plus de panneaux, plus de goudron, juste de la terre, avec ses trous et ses bosses, il ne restait plus que des pierres blanches pour signaler le milieu de la route, elles nous éblouissaient à cause des phares. Sans doute, fallait-il connaître parfaitement le chemin. Le retour s’était fait au début de la nuit, on roulait dans la cambrousse, sans aucune lumière visible. Ce qui nous a marqué toutes les deux, c’est que le bus s’arrêtait parfois là, au milieu de nulle part, pour faire descendre un type ou deux. Il n’y avait aucun village qui les attendait, rien. Où allaient ces gens ? Je ne le saurai jamais.
Son visage m’est un peu flou mais je me souviens qu’il avait une gueule, comme on dirait maintenant. Je me souviens de sa peau grise et de sa maigreur. Nous l’avions rencontré dans la médina. Un vieil homme, ignoré de tous, assis dans la poussière, il avait l’air hors de lui même, comme si une douce folie l’habitait depuis toujours. Il inventait sa propre magie, et proposait un spectacle qui se noyait dans la foule. J’ai d’abord aperçu son chapeau, il bougeait tout seul faisant des mouvements circulaires sur le sol. L’homme bougeait ses mains comme s’il dirigeait ses déplacements. Je revois son visage, sa magie le faisait sourire. Il avait conservé cette innocence qu’on trouve chez les enfants. Je comprends aujourd’hui pourquoi ce vieillard m’avait paru étrangement proche et familier ; un peu comme si cet état de l’enfance si fugace, nous avait fait nous rencontrer pour de vrai. J’étais fascinée par cette scène, je ne sais pas combien de temps je suis restée à l’observer. L’homme avait l’air heureux qu’on le regarde, fier d’avoir trouvé son public. Alors, après son spectacle, peut-être en guise de remerciement, il me dévoila son tour : il saisit son chapeau sous lequel était caché un cochon d’Inde. Le vieillard prit l’animal contre lui et le caressa longuement, comme s’ils prenaient l’un pour l’autre, toute l’importance du monde. Après un temps, l’homme me proposa de prendre son cochon d’Inde. C’était un cadeau magnifique qu’il me faisait là, m’autorisant à rentrer dans l’intimité de son monde. Je me souviens m’être assise à côté de lui et l’avoir remercié. Ce moment a donné lieu à une photographie que je retrouve parfois. Ce vieillard m’avait une dernière fois offert un sentiment d’éternité.
Ce n’est qu’aujourd’hui que je tente de lui rendre un maigre hommage, j’appellerai cette image L’homme au cochon d’Inde.
*