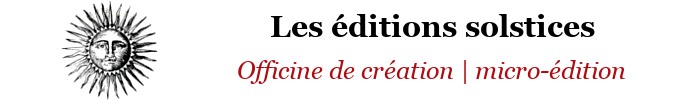Jour un
Les choses sont allées beaucoup trop vite. L’épidémie s’est répandue à une allure impressionnante. Alors que je croyais, en regardant le monde à travers ma télévision, que ce virus resterait loin de moi, loin de nous et de mon cher pays, alors que je croyais qu’il ne quitterait pas la Chine, je me suis voilé la face.
Au fond de moi, à cette époque une angoisse importante était déjà née ; et cette angoisse que je me cachais vainement a finalement eu raison d’être. Aujourd’hui, le virus est arrivé jusque chez nous. La mondialisation, les déplacements humains importants nous ont tous condamnés. J’ai vu ce virus se rapprocher peu à peu, de pays en pays, puis de région en région et de ville en ville. J’ai pu observer sa terrifiante progression jusque devant chez moi.
J’ai vu aujourd’hui sous mes yeux, ce virus s’emparer de mes voisins, les dévorer jusqu’à la dernière goutte de sang.
Jean-Claude, ce vieil homme grisonnant, sortait les poubelles revêtu de son habituelle salopette bleue. Elle était tachetée de sang mais il ne semblait pas l’avoir remarqué. Il saignait du nez si fort que le sang s’écoulait en torrent. Dès lors qu’il s’en est aperçu, je l’ai vu tout tremblant de terreur, emparé par une vive et douloureuse angoisse. Il a toussé, toussé encore.
Il essayait de se maintenir debout s’accrochant à tout ce qu’il pouvait. Sa petite boîte aux lettres branlante est tombée sous son poids l’emportant dans un même mouvement.
Le sol s’est recouvert de son sang brun. Sa femme est accourue, elle a eu le malheur de le toucher, de lui tendre la main ; le virus l’a dévorée elle aussi, bien plus vite encore que son mari qui déjà était emporté dans le gouffre de la mort.
Je ne pouvais plus rester ici, chez moi, un instant de plus. J’ai couru alors jusqu’à ma chambre pour rassembler mes affaires, mais, en voyant mon père au bout du couloir, lui aussi le nez en sang, le corps tremblant et pris de convulsion, j’ai tout abandonné pour fuir, délesté de toute chose.
J’ai seulement eu la présence d’esprit de prendre une bouteille d’eau avec moi.
J’ai ensuite enfourché mon vélo et je suis parti.
Maintenant me voilà, vagabondant sur les routes de mon village. Je ne vois autour de moi que la mort omniprésente recouvrir tous ceux que j’aimais, s’emparer de leur être sans aucune pitié ni aucun remord.
Au coin d’une rue, j’aperçois l’épicerie dans laquelle mes parents se rendaient une fois par semaine, tous les mercredis… Les vitres sont brisées ; du verre jonche encore le sol, témoignant des événements survenus quelques instants seulement auparavant.
Cette pandémie a fait naître chez les gens une telle folie, un tel emportement que la violence jusqu’alors rare est devenue quotidienne.
Je pose mon vélo et pénètre à l’intérieur. Il n’y a personne. Seuls recouvrent le sol, deux cadavres, ceux d’un homme et d’une femme, encore main dans la main. Leur mort est récente puisque leur chaire en lambeau est encore visible. Ils ont dû succomber il y a moins de dix minutes. J’avance en me couvrant le nez dans ce lieu devenu morbide, où toute chaleur a fui bien loin. Le magasin est presque vide. Il ne reste que quelques fruits que je ne peux prendre le risque d’emporter. Le virus les a peut-être déjà contaminés…
Mais il y a des conserves. J’aurai de quoi manger.
Alors que je m’apprête à m’en emparer, j’entends soudainement du bruit derrière moi. Des gens se rapprochent. Je les entends s’avancer follement dans les rues, en courant, recouvrant de leur cris les sirènes qui hurlent depuis des jours dans les villes.
Instinctivement je me couche sur le sol derrière un des rayons, à coté du cadavre de l’homme dont l’odeur de décomposition me fait déglutir.
Quelqu’un entre dans l’épicerie. J’entends ses grosses bottines faire craquer les morceaux de verre.
Je l’entends rire, d’un rire de folie pure.
– On va se nourrir, on va se nourrir !
Il s’approche lentement des bananes. De là j’ai peur qu’il me voit alors je m’écarte un peu plus. L’angoisse me tétanise lorsque je m’aperçois que ma main est à deux doigts du cadavre. Une subite envie de pleurer me prend mais je me contrôle. J’essaye seulement de ne plus bouger, de rester immobile, là, dans mon inconfort.
Puis tout se passe très vite. Il a attrapé les bananes. Je le sais, je le sens car déjà je l’entends tousser. Une dame, prise dans l’hystérie de la pandémie court derrière lui. Je me risque à jeter un œil. Elle lui arrache ses vêtements, hurle, et le griffe avec une rage certaine.
Elle lui dérobe les bananes. Il tombe convulsionné dans une marre de sang rougeoyante alors qu’elle s’esclaffe toute joyeuse :
– Salaud ! Tu l’as mérité ! Elles sont à moi ces bananes ! À moi !
Mais déjà, sa joie s’arrête, dans une toux sèche, ensanglantée. Elle jette les bananes, porte ses mains à son nez rougeoyant et vient peindre de son sang le mur jaune de l’épicerie, avant de s’écraser lourdement par terre.
Devant toute cette horreur, je me relève, j’attrape les conserves et, tout en courant je me sauve, en évitant tout ce sang écœurant.
Je repars aussi vite sur mon vélo, à toute allure, pleurant et dégobillant la bile qu’a fait naître cet épisode.
Jour deux
J’ai trouvé un abri dans un petit bois, éloigné de toute civilisation. Je n’ai plus de famille, plus d’amis, plus de proches. Ils sont tous morts. Je ne sais pas combien de temps je vais survivre. Je ne sais pas si je vais tenir longtemps. Il ne me reste plus qu’une seule conserve. Mon vélo est crevé. J’ai peur.
Vers midi, j’ai trouvé un petit chien. Il était tout seul, accroché à un arbre. Quelqu’un l’a abandonné, là, le laissant seul face à son sort. Cette pandémie révèle la cruauté de l’être humain qui, égoïste et sans cœur abandonne les animaux, les jetant comme de vulgaires objets pour limiter leurs risques de contamination et se délester de ce qu’ils voient comme un fardeau. Ils veulent limiter les bouches à nourrir. L’humanité me répugnera toujours autant.
En le voyant ainsi, couché faiblement au pied de l’arbre, je n’ai pas pu rester impassible. Je l’ai emmené avec moi. Je l’ai nommé Bill. Il m’accompagnera dans mon parcours. Je vais essayer d’atteindre Colmar. J’ai entendu dire que cette ville était sûre, protégée et qu’elle recelait de nombreux abris.
Il est 13h et je me rends compte que Bill est affamé. Il peine à me suivre. Il a dû rester seul dans cette forêt sans nourriture et sans eau pendant des jours. Je lui ouvre ma dernière conserve mais c’est à peine s’il y touche. Sa petite queue blanche remue faiblement, il lèche le bord de la conserve avant de s’allonger sur le sol, les oreilles retombées.
Il me fait mal au cœur, il refuse aussi l’eau que je lui propose. Il n’a pas l’air de pouvoir avancer, il a l’air si faible… Mais je ne peux pas le laisser là.
Vers 16 heures, après avoir parcouru des kilomètres en portant Bill sur le dos, je décide de faire une pause. Mon dos me fait atrocement mal tout comme mes jambes et mes pieds qui n’ont pas l’habitude d’être autant utilisés. Je suis toujours dans la forêt. Je longe les routes en restant caché dans les bois. Je ne veux croiser personne.
J’ai fini la dernière conserve, je n’ai pas su la garder. Je n’ai plus d’eau non plus. Je ne sais pas comment je vais survivre. Les choses s’annoncent mal. J’ai peur, j’ai faim, j’ai soif, j’ai froid, Bill semble abattu et le soir arrive.
Jour trois
Bill va mal. La nuit a été rude. Je n’ai pas su fermer l’œil plus d’une ou deux heures. Bill n’a pas cessé de gémir à chaque instant. Il semble souffrir terriblement d’un mal que je n’arrive pas à comprendre. Il ne veut plus du tout avancer. Il ne tient pas debout. Il tombe directement lorsque je veux l’aider à marcher. J’ai peur pour lui, j’ai peur pour nous.
Nous n’avons plus rien à manger ni à boire et il n’a toujours rien avalé depuis que je l’ai découvert.
J’ai essayé de reprendre la route avec lui, en le portant mais je n’arrive pas à avancer. Je n’y arrive plus. Tout mon corps me fait souffrir. J’ai des nœuds dans l’estomac et malgré tous mes efforts je n’ai pas fait plus de deux kilomètres en deux heures. Je suis obligé de m’arrêter toutes les deux minutes pour poser Bill. Malgré sa maigreur, il est lourd et mes forces commencent à me manquer.
J’ai aussi eu une hallucination à cause de la fatigue, de la faim, de la soif.
Tout s’est brouillé autour de moi, j’ai vu danser une infinité d’étoiles autour de moi, puis j’ai eu l’impression de manger une bonne glace à la vanille. Je la dégustais avec délectation. C’était la meilleure glace que j’avais jamais mangée de toute ma vie. Mais quand j’ai ouvert les yeux, j’ai compris que je ne léchais que la râpeuse écorce d’un arbre.
À force de lécher, j’avais la bouche en sang, ma langue coupée à de multiples endroits était recouverte d’échardes que j’ai souffert pour les retirer. J’ai voulu pleurer une fois de plus mais les larmes me manquaient elles aussi.
Je me sens desséché. J’ai l’impression que je vais mourir. Bill n’arrête pas de gémir. Il reste couché au sol. J’ai l’impression qu’il pleure. Je ne sais pas quand le malheur me laissera.
Jour quatre
Bill est mort. Je l’ai retrouvé raide ce matin. Il ne bougeait plus. Ses yeux vifs étaient rivés droit devant lui. La dernière vision qu’il a eue devait être celle de la route qui, plus loin, prend forme.
Je lui ai fermé les yeux et avec le peu de force qu’il me reste je l’ai enterré. C’est le moindre que je puisse faire pour ce compagnon qui m’aura accompagné dans ma douleur. Je n’ai plus personne désormais. Je suis seul, sans force. Je ne sais plus où aller.
J’ai d’abord voulu laisser le hasard parler. Puis j’ai repensé au dernier regard de Bill. Il pointait vers cette route grise et après avoir avancé, j’y ai découvert une voiture rouge à l’abandon. Un petit tout terrain, qui, par la chance du destin, avait encore les clés sur le contact.
J’ai vérifié attentivement qu’il n’y avait personne ni à l’intérieur ni aux alentours.
J’ai essayé de démarrer et le petit bruit du moteur s’est tout de suite ravivé, faisant renaître en moi un espoir oublié.
Alors que je ne savais plus où aller, cette voiture dotée d’un GPS pouvait me guider jusqu’à Colmar.
Cela fait maintenant trois heures que je roule, un panneau annonce Guenviller à l’instant même où la voiture me lâche. Elle s’arrête tout à coup dans un bruit infernal. Le moteur sursaute et se met à fumer. La peur revient au galop alors que je sors du véhicule en courant, redoutant une quelconque explosion. Mais il ne se passe rien. Seule la fumée continue à sortir du capot.
Sans chercher plus loin, je repars à pied sans avoir d’autre choix que de rentrer dans cette commune peuplée d’habitants…
Les rues sont désertes. Il n’y a personne. Cette solitude me paraît irréelle. J’ai l’impression de me trouver dans un film post-apocalyptique. J’avance doucement, à l’affût du moindre bruit, du moindre mouvement, du moindre signe de vie, du moindre danger. Mais il n’y a toujours rien ni personne.
Alors, lorsque je découvre la porte d’une maison encore ouverte je prends le risque de me glisser à l’intérieur. Il est temps de faire le plein de nourriture et d’eau.
La première chose que je constate c’est l’odeur forte et pestilentielle. La seconde, les cadavres qui se rattachent à celle-ci. Il y en a d’abord deux dans le couloir de l’entrée. Ce devait être une mère et sa fille, ou son fils ; il ne reste plus rien que des os, des vêtements en lambeaux et des morceaux de chair et d’organes qui se baladent partout sur la moquette tachée, complément recouverte de sang. Je découvre ensuite le cadavre d’un homme à en juger par les restes de ses habits sombres noyés par le sang.
Devant tous ces débris de gens je ne peux m’empêcher de dégobiller à nouveau sur le sol sombre et terreux. Il a dû être foulé par des pillards car tous les placards sont ouverts. Il n’y a plus rien ici.
Je garde tout de même espoir de découvrir de la nourriture au sous-sol.
Je descends dans cette obscurité effrayante. La lumière ne veut pas s’allumer, seul un fin jour éclaire faiblement cette pièce neuve que je découvre. Je ne trouve rien d’autre qu’un vieux bocal de haricots périmés. Je le prends malgré tout. En ces temps durs, tout est bon à prendre.
Mais, alors que je remonte l’escalier, j’entends un bruit sourd derrière moi.
Pris de panique je me fige et serre davantage la rambarde. Le bruit recommence. Je tourne la tête, il n’y a pourtant rien. Il recommence encore et encore.
J’arrive à surpasser mes peurs et, prenant mon courage à deux mains j’approche de leur origine.
« Pam » « pam » « pam ». Les coups sont vifs, étouffés. J’approche toujours à pas feutrés vers le congélateur d’où proviennent ces bruits toujours plus imposants.
Et alors que je l’ouvre, je tombe à la renverse, abasourdi.
Jour cinq
Elle s’appelle Éléonore. Ses parents qu’elle a retrouvé morts en montant avec moi, l’avaient enfermée dans ce congélateur où elle était prisonnière depuis des jours. Ils étaient d’horribles personnages. Elle m’a décrit toutes les choses plus horribles les unes que les autres qu’ils lui ont fait subir. Elle m’a parlé de son chien qu’ils ont égorgé devant elle pour ne pas avoir à le nourrir et, comme elle pleurait, comme elle hurlait, ils l’on punie en l’enfermer là, dans le congélateur de la cave. Elle a failli mourir de froid. Mais très vite, des pillards ont fait disjoncter la maison. Elle a eu beaucoup de chance de s’en tirer vivante.
Hier nous avons trouvé une maison vide où nous abriter. Il y a de la nourriture et de l’eau à outrance. La famille qui habitait les lieux s’était préparée à un confinement avant de disparaître mystérieusement. On a même retrouvé un revolver dans la commode de la chambre.
Elle ne veut pas partir pour le moment, elle veut que je reste à ses côtés. Elle dit qu’il y a de quoi survivre pendant un temps. Nous sommes à l’abri, nous ne craignons rien.
Jour six
Éléonore me fait peur. Elle ne veut plus me laisser partir. Elle a une attitude étrange qui m’angoisse, elle n’arrête pas de rire toute seule. Elle s’est emparée des couteaux dans la cuisine…
Elle me fait vraiment peur.
Je me suis enfermé dans la chambre. J’ai voulu prendre le revolver mais il n’y est plus. Elle a compris. Elle parle. Je l’entends.
– Non tu ne partiras pas. Tu ne me laisseras pas ici, je suis obligée de faire ça, c’est pour ton bien, sors d’ici, sors d’ici mon petit chou, viens t’amuser avec moi, allez ! Allez ! ALLEZ !
J’ai entendu un coup. Une balle est partie. Il y a un trou dans la porte. J’ai peur.
– Viens mon chou à la crème, on va s’amuser, je vais jouer avec toi. Tu veux voir ce que j’ai là ? Regarde. Mon chou ?
Je vois son œil apparaître dans le trou de la porte. Elle me terrifie. Je regarde autour de moi. Il faut que je sorte de là. Il faut que je trouve un moyen de lui échapper.
– Mon chou ? Alors tu fais ton timide ?
« Pou » « Pou » « Pou ». Trois nouveaux coups retentissent. Le trou s’est agrandi. Elle donne maintenant des coups de couteau dans la porte. Le bois retombe sur le sol, dépecé en un millier d’échardes. Je vois maintenant sa main traverser la porte. Elle la tend vers la poignée qu’elle serre fort. Elle tourne le verrou devant mon inaction. Elle entre en riant de plus bel.
– Alors mon chou ! Tu faisais quoi tout seul enfermé, hein ? Tu n’attendais pas ta femme ?
Sa voix se met à changer brutalement devant mon effroi. Elle s’assombrit et son rire de plus en plus glaçant galvanise tout mon être, le recouvrant d’une épaisse pellicule de terreur. Je me sens noyé par cette souffrance. Mon heure est venue, je vais mourir. C’est ainsi que se passe la mort ? Pourquoi je ne revois pas les dernières images de ma vie ? Pourquoi cette sombre image reste ainsi devant moi ?
Elle s’approche raillant ma mort qui je le vois bien est presque palpable. Elle m’entoure, me recouvre, m’étouffe.
Éléonore tire sa main vers l’arrière pour prendre l’élan nécessaire à me percer l’estomac, et, alors qu’elle allait y parvenir, son nez se met à saigner ; des convulsions lui tordent le corps.
– Merde ! Non ! Putain non ! Pas moi ! Non ! C’est pas possible ! Non !
Je la vois hurler de douleur, pleurer dans son malheur avant de s’éteindre devant moi.
Comme si je risquais encore quelque chose, je fuis à toutes jambes, m’empare des clés de voiture des anciens habitants de cette maison, plus effrayé et plus faible que jamais.
Jour sept
J’y suis arrivé, je suis à Colmar. Cette ville est protégée, j’y suis à l’abri. Il y a de quoi manger. Tout le monde m’a accueilli à bras ouverts. Je ne risque plus rien. Alors, une fois dans la chambre qu’on m’a donnée, je décide de prendre une bonne douche. Et, alors que je retire mes vêtements, je vois une tâche que j’essaye tant bien que mal de faire partir en frottant avant de comprendre. C’est une tâche de sang, celui d’Eléonore. Je me sens faible tout à coup. J’ai froid. Mon nez saigne. Je tremble. Je tousse. Je me retiens à ce que je peux. Mais je tombe, j’ai toujours su que ça finirait comme ça…
*