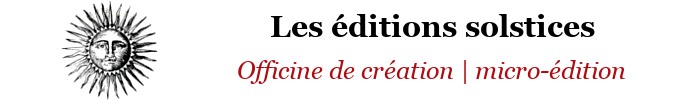J’ai toujours été, depuis l’âge adulte, au contact des drogues. Je les considérais comme je considérais mes amis : familières, amusantes, terrifiantes parfois. Je ne sais si ce sont les substances elles-mêmes ou la terreur qu’elles me faisaient éprouver, mais j’y retournais assurément et avec une assiduité rigoureuse. Il y a cinq ans, pas très sûr de mes ambitions mais contraint à des nécessités communes, je travaillais dans une usine en Vendée. Je retirais, à la chaîne, les parties non comestibles de pigeons que je déplaçais ensuite machinalement sur le tapis adjacent. Peut-être étaient-ce ces automatismes qui m’ont rendu fou, qui ont excité en moi le désir d’un imaginaire éloigné de ces mains grasses et de ce silence ponctué par le chant mécanique des installations. La réalité résonnait déjà en moi comme une mauvaise montée. J’en recherchais frénétiquement une nouvelle, un peu plus récréative et dense que la première.
Nous avions pour habitude, avec mon ami Raphaël, de nous retrouver tous les vendredi soir en compagnie d’autres personnes qui devenaient, passé vingt-deux heures, des personnages. Raphaël, grâce au hasard bienheureux de ses traits, parvenait toujours à faire venir de très jolies filles, pas encore tout à fait femmes alors. Le charisme naturel de mon acolyte lui donnait, de droit, la plus belle des créatures de la nuit en question. Je réussissais parfois à séduire la plus laide, et j’en étais content.
L’usine a fermé deux semaines en juin 2014, dû à un problème d’hygiène dont les causes sont toujours restées plus ou moins obscures aux ouvriers. Chômage technique. Raphaël fréquentait alors une jeune institutrice – Louise – qui, très amoureuse de lui, souhaitait le lui montrer de toutes les façons possibles. Ses parents avaient une grande maison sur l’île d’Oléron dans laquelle elle invita toute la bande pour une semaine. Nous arrivâmes tard, la nuit était déjà tombée. Une amie de Louise – je ne me souviens plus de son nom – nous proposa naturellement de l’acide qu’elle avait transporté depuis l’Allemagne, niché dans ses sous-vêtements. Je pris une triple dose. Je ne vis jamais l’île.
Premier jour
Raphaël est en train d’embrasser Louise, j’ai la sensation que leurs bouches sont soudées. Louise a enroulé ses bras autour de ses épaules. Leurs corps, collés et impudiques, prennent rapidement la forme d’une porte. Je me retrouve alors dans un long couloir qui me semble être celui d’un hôtel miteux. Je me rapproche de la porte, un encart est à sa droite sur lequel il est inscrit d’une cursive qui ressemble à celle d’un enfant : « Hermann Hesse – Le loup des steppes ». Une petite tête de loup est dessinée au feutre sur le mur. Je me souviens vaguement de la lecture de ce livre : j’entre.
Je suis dans un club du début du siècle dernier, un groupe de jazz se produit dans un nuage de fumée opaque, la piste de danse est remplie, je sens une forte odeur de sueur.
-
Quelle heure est-il ?
Hermine me fait signe, en positionnant sa main en coquillage contre son oreille, qu’elle ne m’entend pas. Je lui répète ma question en hurlant dans ses cheveux. Elle rit, fort je crois : elle ne le sait pas, et elle s’en fiche parfaitement. Elle me prend par la main et me tire le long de la piste jusqu’à Harry Haller qui danse avec Maria. Je suis très impressionné, je m’approche pour lui embrasser les joues, il a un mouvement de recul. Nous sommes en 1912, je réalise que mon comportement n’est pas adapté. Je baisse les yeux et le remercie pour son traité dont je me souviens maintenant avec une précision émue.
– Quel traité ?
Il ne le sait pas. Évidemment. Je sais bien qu’il veut mourir ; je voudrais le prendre dans mes bras. Je m’abstiens et j’observe Maria qui danse. Elle est très belle. Je comprends ce que Harry peut rencontrer dans ces deux femmes qui, additionnées, effleureraient une idée d’idéal. Nous nous faufilons derrière la scène. Hermine, Harry et Maria sortent de leurs manteaux une bouteille de whisky – chacun. Nous buvons. Hermine et Maria dansent ensemble, en silence cette fois, les yeux joliment révulsés. Je parle avec Harry qui, bien qu’ayant beaucoup trop bu, articule parfaitement ses pensées distordues. Il évoque ses amours, les sexes qu’il a vus, sentis, les femmes qu’il a rencontrées sans savoir quelles marques elles allaient ancrer en lui.
– « Chacune avait son mystère, embaumait son climat, baisait et riait à sa façon, était pudique comme il n’appartenait qu’à elle, luxurieuse, comme elle seule savait. Elles allaient et venaient, le courant les amenait à moi, m’attirait à elles, m’entraînait loin d’elles, c’était un flottement enfantin et enjoué dans le fleuve du sexe, plein de charmes, de dangers, de surprises. Et je m’émerveille de voir combien ma vie, ma pauvre vie de loup des steppes sans amour, [a] été riche en chances amoureuses, en tentations, en possibilités. » (p.206, Le livre de poche, 2008)
Je comprends qu’il se parle à lui-même et que les hochements de tête que je lui adresse avec mes grands yeux admiratifs ne changent rien au cours de sa pensée. Je le laisse apprécier sa propre ivresse des sens et me recule en titubant vers la porte qui mène à la piste de danse. La poignée est d’une saleté sans pareille, je la saisis en m’effondrant en avant de tout mon poids. Le corps au sol et la mâchoire embrassant sa lignée, je lève les yeux. Je vois le même couloir d’hôtel, le carrelage mal paré et le papier peint arraché par endroits. Je tourne la tête : le petit loup au feutre ainsi que la porte ont disparu.
J’avance alors sans intention particulière, le souvenir de Harry marqué au fer rouge sur la terre de ma mémoire. J’ai envie de vomir. Je saisis la première poignée sur ma gauche afin de trouver un appui correct pour dégueuler. La poignée saute, je trébuche sur mon pied gauche – désormais plein de matières encombrantes – et me retrouve dans une pièce d’un noir franc.
Deuxième jour
L’odeur est abominable. Allongé sur le ventre, pareil à l’attitude de mon corps en plein sommeil, je sens sur mon dos des lattes qui m’empêchent de me relever. J’entends un souffle rauque, inhumain et pourtant timide, comme s’il se contenait. Je rampe alors sur le côté – trempé de ma propre sueur – jusqu’à me libérer du confinement qui s’exerce contre mes omoplates. Le noir est toujours impressionnant d’opacité. Je m’assois quelques minutes, tant angoissé qu’intrigué par ce bruit de respiration que je ne reconnais à personne. Mes yeux s’habituent peu à peu à l’obscurité. Je discerne les formes d’un canapé, d’un tas de livres entassés dans un coin de la pièce, d’une table bien ordonnée dont on sent très vite la poussière qui vient démanger vos naseaux. Et puis une forme difforme qui se déplace lentement le long du mur et de ses angles. Alors, instantanément, je sais.
– Gregor ?
La bête s’arrête aussitôt. Elle ronfle dans ma direction sans oser s’approcher. Rassuré de figurer le roman dans lequel je me trouve, d’autant que je sais ne pas avoir à m’inquiéter de mon compagnon, je m’approche de Gregor. L’ignoble cafard me fixe de ses grands yeux disproportionnés. J’approche ma main de l’une de ses pattes et la caresse d’une lenteur implacable en signe de reconnaissance. Gregor ne peut pas me reconnaître à son tour. Pourtant, je ressens dans le mouvement de ses antennes et dans la position de sa carapace l’élan d’émotion et de soulagement qu’il ressent à mon geste.
– Kafka ? Est-ce bien ton maître ?
Gregor ne comprend pas. Il ne pourrait me répondre quand bien même il le comprendrait. L’instinct animal – unique gain de sa Métamorphose – lui fait goûter ma bienveillance. Nous nous allongeons ensemble. Je suis fatigué. Je lui parle de mes dernières lectures, lui conte un des derniers prix Goncourt – cet auteur méritant mais quelque peu salaud –, les nouvelles du pays des décennies plus tard. Il m’écoute, silencieux, ébahi. Je doute du fait que s’il avait été encore humain il eût réagi différemment.
Grete entre sans frapper. Elle hurle : « Gregor n’est pas planqué ! » Elle doit voir un homme allongé près de son cafard de frère lui relater les actualités. J’ai peur de changer le cours du roman. Je me lève, m’approche d’elle ; elle est tétanisée. Je lui crie dans la bouche. Elle s’évanouit. Je donne quelques coups de pieds dans son dos de traître, ferme la porte, jette un regard entendu à Gregor, et l’ouvre de nouveau. Je me trouve dans le couloir de l’hôtel. Rassuré, je m’assois quelques minutes et reviens sur le comportement que j’ai tenu auprès de Gregor. Soucieux de sa mort solitaire, je pleure un peu. Je m’endors, je crois. Peut-être contre le mur de l’établissement ; probablement aux pieds de Louise mouvant par à-coups grâce aux reins de Raphaël.
Je me réveille quelques temps plus tard – je ne saurais préciser. Le même couloir d’hôtel, le même papier peint pendant qui laisse à désirer, le même sol douloureux si l’on n’y fait pas attention. Je suis dans une forme olympique. J’ai la sensation d’avoir mangé pour quatre, lu pour deux, et de penser pour une nation entière. Je marche bêtement le long de l’allée, les yeux fermés. Je m’arrête enfin devant une porte dont je lis la note : « Homère – L’Iliade ». Fort de mon état physique, je m’engage et pousse le battant en contre-plaqué.
Troisième jour
La foule est innombrable, compacte, les coups décuplés par rapport à mon souvenir. Je me baisse et dévie une lance qui réclamait mon cou. Je m’observe. Mon corps est entièrement paré d’un métal lourd que je n’ai jamais vu, qui m’handicape et me protège à la fois. Je recule et observe les Achéens. Comment les dissocier de mes ennemis ? J’élude la question et avance alors, pris d’un élan d’adrénaline – kétamine – qui m’élance contre le camp adverse que je décide d’identifier par la direction opposée. Je ne saurais nommer l’arme que je porte tant elle m’est indéfinissable ; pourtant je blesse une, deux, trois personnes avec. J’ai une brève pensée pour elles qui gisent désormais au sol sans pouvoir vraiment ni mourir ni poursuivre leur violence. À la guerre comme à la guerre. Je hurle d’une fureur qui ne m’appartient pas. Les aèdes m’emportent peut-être ; peut-être suis-je le sujet du chant d’une sirène qui ne sait plus se taire : en tout cas, je ne suis plus maître de moi.
Mais c’est moi qui me bats, et c’est moi qui tue. Si je ne tue pas, je sais au moins rester vivant. Ajax s’approche et me serre la main. Il la tord : j’ai mal pour la première fois, dans une cordialité intime
Il me parle grec. Je ne comprends rien. Il faut préparer ses défonces, quand bien même on ne prévoit jamais vraiment leur teneur.
Ulysse me regarde avec insistance : « Rentre, Rentre. Si tu peux rentrer, rentre. ». Ses yeux étranges m’observent, nébuleux, fuyants. Je le considère ensuite pourfendre les Troyens, sans pitié, fort de ses bras de fer et de son cœur de pierre, envisageant chaque homme comme une étape de chair qui le rapprocherait un peu plus de sa femme et de son fils. Plus rien n’a d’importance sinon le retour.
L’excitation du champ de bataille me quitte. Je ne suis pas prêt à mourir – si on l’est jamais vraiment – je fais une crise d’angoisse. Je suis alors allongé au sol, j’agrippe mes jambes que je ramène contre mon torse, roulé en boule. Je pleure. Du sable me rentre dans la bouche, je n’arrive plus à respirer, je me fais passer pour mort. De nombreux guerriers me passent sur le corps, écrasent de leurs pieds alourdis par le bronze mes côtes, mes pieds, mes épaules. Ils évitent par chance mon crâne que je ne protège plus, tétanisé. J’implore alors silencieusement quelque dieu païen qui pourrait me venir en aide. Aussi je vois Athéna qui se tient au-dessus de moi, affublée de grandes bottes à talons et d’une jupe midi, seins nus. Elle fait claquer entre ses dents un rire parfait et me prend dans ses bras comme l’on porterait un enfant endormi.
– Aurore aux doigts de rose approche ! Et toi, étranger au cœur de biche, retourne d’où tu viens.
Elle me caresse la joue et clôt doucement mes paupières. Je me réveille dans le couloir de l’hôtel qui m’est désormais familier. Un miroir au tain altéré se trouve un peu plus loin dans l’allée. Je m’y observe et constate à ma temps l’apparition d’une épaisse cicatrice. Raphaël sera fou de jalousie lorsqu’il la verra ! Une petite porte en bois au sommet arrondi se trouve à côté du miroir. Je lis l’encart : « Umberto Eco – Le nom de la Rose ». J’entre.
Quatrième jour
L’abbaye est plongée dans le noir. Je me trouve dans le cloître à l’intérieur duquel quelques moines se pressent vers un passage voûté. J’aperçois Guillaume de Baskerville qui me fait signe que les vêpres vont débuter. Adso le talonne et me lance un regard inquisiteur : je lui suis inconnu.
Nous nous asseyons au dernier rang et écoutons attentivement le discours de l’homme en tenue monacale. C’est interminable. Cette fois-ci, c’est le latin qui me fait défaut. Définitivement, les drogues nécessitent une initiation aux lettres classiques. Une fois l’office terminé, Guillaume me propose de dîner avec lui et les autres moines. J’accepte avec joie. Nous buvons un vin rouge qui ne ressemble en rien à celui que j’ai pu avoir l’habitude de consommer. Adso est, sans grand étonnement, assez silencieux. Il boit les paroles de son maître qui, bien que franciscain, s’abreuve et mange très correctement. Je remarque ses sandales qui seraient aujourd’hui de véritables reliques, et je ne peux m’empêcher d’accorder à chacune de ses formules une attention toute dévote.
Guillaume s’intéresse particulièrement à l’innovation, à l’ingénierie et à l’accès au savoir pour tous. Peut-être un peu saoul, à cause de sa consommation d’alcool, d’habitude plus légère, il se lance dans un discours sur l’optique, science qui le fascine plus que les autres, pour la simple raison qu’elle touche sa capacité à lire. Je le questionne sur le terrible joug du pape Paul XXII, alors domicilié à Avignon, sur l’inquisition et sur sa vision de l’hérésie. Je lis dans son regard qu’il me trouve un manque de prudence inconsidéré. Pourtant, avec toute la bienveillance de cet homme – que je connais déjà – est capable, il me répond précautionneusement, avec une méfiance érudite dont je tombe amoureux.
Adso s’enquiert de l’enquête qu’ils mènent actuellement et des morts mystérieuses qui s’enchaînent dans l’enceinte. Je voudrais leur délivrer le nom du coupable, mais rien ne sort. Il ne faut pas perturber le cours du récit qui perdrait toute sa raison d’être.
Les deux amis proposent de m’emmener avec eux fouiller l’atelier de Séverin, le moine herboriste. Ce dernier dort déjà et Adso est parvenu à lui subtiliser les clefs. Nous nous dirigeons donc dans un silence religieux vers la dépendance de Séverin. La salle est oblongue et tient du cabinet de curiosité. Les pots n’étant pas parfaitement hermétiques, une vive odeur de plantes demande un léger temps d’acclimatation pour surpasser le malaise. Guillaume prend un plaisir immense à m’indiquer les propriétés de telle ou telle racine, à m’apprendre la culture des graines, la rareté de certaines d’entre elles et le danger que représenterait le maniement de quelques herbes si l’on n’était pas suffisamment renseigné. Adso, impatienté, nous fait signe qu’il faut partir. Je tourne la clef épaisse, je sors.
Guillaume et Adso ne sont plus là, toujours le même couloir. J’ai un peu trop bu et ressens le besoin de m’asseoir. Je parcours les encarts un à un, hésitant mais pressé, jusqu’à m’arrêter devant celui-ci : « Michel Butor – La Modification ».
Cinquième jour
Le train ronronne, je suis face à Léon Delmont. Le compartiment est vide, je m’attendais à ce que nous soyons accompagnés. J’aurais souhaité loucher sur le mauvais livre de mon compagnon de droite. Mais les quatre places sont bien là, abandonnées. Seuls, nous occupons la lignée près de la fenêtre, Léon à contre-sens, face à moi. Il me dévisage. Il observe mon pantalon à bretelles, mes mains, mes chaussures de mauvaise facture avant de revenir sur ma figure.
– Je suis amoureux de ma femme, vous savez ?
En l’entendant m’aborder aussi maladroitement, je suis heureux. Il me semble que je n’aurai pas à faire trop d’effort afin de suivre les contingences de sa pensée, que je sais déjà aimer.
– Oh, je suis très amoureux de ma maîtresse également. Vous le savez. Je le vois à votre regard. Et puis je me suis trahi tout seul en vous déclarant que j’aimais ma femme. Le fait de se sentir obligé de le déclamer à un inconnu qu’on aime sa femme témoigne bien du fait qu’on ne l’aime plus assez. En tout cas, pour moi, plus exactement comme je le voudrais.
Il laisse passer un silence durant lequel il observe le paysage qui défile sur sa droite. Il me semble alors que, dans un effet cinématographique propre à l’esprit, il y voit ses deux femmes danser ensemble, leurs yeux qui regardent ses yeux ; leurs reproches et leurs désirs s’asseoir dans leurs œillades.
– Voulez-vous du vin ? Il doit m’en rester un verre ou deux : la carafe du plateau repas de ce midi n’est pas terminée. Vous êtes arrivé après le service. Non ? Très bien. En effet, vous avez déjà le rose aux joues. Je ne vous demanderai pas ce que vous avez bien pu faire. Ce sont ces choses que je me demande à moi-même et que je suppute en vous observant en détail. Mais il se trouve que je vous parle. Et si même je me décidais à me taire, je ne pourrais plus continuer à vous regarder comme un inconnu pourrait s’en donner les droits. Vous auriez alors la porte ouverte pour me demander ce à quoi je pense en vous dévisageant ainsi. Vous n’auriez jamais osé le demander à un inconnu trop indiscret : mais voilà, c’est trop tard, nous nous sommes parlé. Ou plutôt, je vous ai parlé. Je ne peux plus vous observer à ma guise. C’est dommage, car vous êtes assez peu bavard, et votre physique ne dit pas grand-chose de vous non plus. Vous êtes d’une telle banalité qu’elle me pose question.
Je suis parfaitement, dans sa prise de parole, le fil de sa pensée avortée, maladroite mais belle. Aussi je me retire du champ du langage et le laisse s’évertuer à s’analyser lui-même sous prétexte de m’analyser moi.
– Que feriez-vous face à la beauté brute lorsque vous avez déjà l’amour ? Honnêtement, et vous l’aurez compris, je suis perdu. La beauté n’est-elle pas inhérente à l’amour ? Trouver chez quelqu’un de la beauté dans une disgrâce entendue n’est-il pas synonyme d’aimer ? Combien de temps cela dure-t-il ? La durée dépend-t-elle de la personne que nous aimons ou simplement d’une péremption obligatoire que nous portons indéfiniment entre notre sexe et notre cœur ? Je vous prie de m’excuser. Je ne suis pas poète, seulement malheureux. Le malheur a tendance à faire ressortir en nous des mots que d’ordinaire nous n’utilisons pas. Les malheureux écrivent des vers, les gens heureux les moquent. C’est cyclique, vous savez.
Je dois me rendre aux toilettes. Je me fais excuser auprès de Léon et referme la porte qui claque dans un appel d’air.
De nouveau ce couloir. Je suis, cette fois-ci, déçu. J’aurais souhaité rester plus longtemps dans ce wagon à destination de Rome, sans pour autant m’y rendre. La Modification était reposante. Je restai immobile et écoutai religieusement les pensées de Léon, qui m’évoquaient évidemment d’autres pensées plus personnelles. Une porte bleue est face à moi, elle est percée d’un petit hublot sur lequel est apposée une étiquette : « Jack London – Martin Eden ».
Sixième jour
Le pont du bateau est humide, une tempête a eu lieu la veille. Quelques ouvriers brossent énergiquement le sol en bois, une fine pluie vient rouler sur mon front. Un homme est en costume militaire marin, je lui demande la cabine de Martin Eden. Sans m’adresser la parole, il m’indique vaguement la direction de ses grandes mains calleuses. Je longe les planches en essuyant mes joues avec la manche de mon caban. Je trouve l’homme que je cherchais en train de fumer une cigarette, considérant l’étendue d’eau en silence. Je me présente sous un faux nom, quand bien même conserver mon anonymat n’a rien de nécessaire, et lui fais part de l’admiration que j’ai pour son travail. Martin ne me regarde pas, il finit sa cigarette comme si je n’étais pas là. Je reste immobile, attendant sagement qu’il daigne me répondre. Je voudrais seulement connaître le son de sa voix.
Il finit par me demander, sans pour autant lever les yeux vers moi, quels sont les travaux que j’ai pu lire de lui. Je m’empresse de lui signaler avec une fierté d’enfant que je lis ses poèmes depuis ses débuts, lorsqu’il besognait encore afin d’être publié dans des journaux de bas étage. Je m’intéresse alors au fossé qui a pu se créer entre le Martin excité d’un amour admiratif pour Ruth Morse et le Martin Eden respecté et ancré dans le monde cruel de la littérature. Il semble enfin mesurer ma présence, probablement surpris que je connaisse le nom de Ruth. Pourtant il ne semble pas enclin à me poser de question à propos de ma curiosité bien renseignée. Il me répond simplement : « Il n’y a pas de fossé entre moi et moi-même. Le fossé réside dans les personnes qui vous considèrent ou ne vous considèrent pas selon la considération que veut bien vous porter votre voisin. »
– Vraiment ? Le besoin de reconnaissance peut s’assouvir un jour ?
Martin me lance un sourire amer, un de ces sourires où se cache une vérité qu’on ne souhaite pas partager. Pourtant, fort de ses années de travail sans relâche et dans la perspective de sa propre mort, il se tourne vers moi.
– Le besoin de reconnaissance est assouvi lorsque tu ne reconnais plus personne. Je ne te le souhaite pas. Admirer l’autre est vital. Se haïr de temps en temps te permet de rester en vie. Le désir de prouver surpasse tout désir de luxure. Il rejoint celui de l’orgueil mais le dépasse dans le même temps. Il est essentiel d’être mauvais, quelque part. Es-tu mauvais ?
– Je suis terriblement mauvais.
– Bien. Tu vivras longtemps.
– Est-ce une bonne chose ?
– Une bonne chose, une bonne chose ! Je n’en sais rien. C’est un constat, pas un brevet philosophique.
Je me sens idiot un instant, ça ne me dérange pas. Si Martin se jette dans l’océan ce soir, il me gardera en vie encore un peu grâce à la rencontre de son arrogance et de mon esprit faible. Je le remercie et lui demande si je peux entrer un instant dans sa cabine. Je prends son silence pour un oui et passe le seuil de la porte.
Le couloir me semble un peu plus sombre qu’à mon dernier passage. J’ai une montée d’angoisse et j’éprouve des difficultés à respirer. Je décide d’emprunter le premier roman qui croisera ma route : « Gabriel Garcia Marquez – Cent ans de Solitude ».
Septième jour
C’est jour de fête à Macondo. Les gitans ont installé leurs tentes, une forte odeur de gibier dévore l’air, des feus brûlent près des campements. Les femmes sont parées de longs colliers qui viennent leur caresser le ventre. Les bagues et les bracelets, nombreux, viennent se rencontrer dans un cliquetis qui semble accompagner la musique jouée sur la place. Les hommes, d’une beauté sauvage, sont torses nus et font rugir leurs guitares. Leurs yeux sont fermés, leurs bouches entrouvertes, permettant d’entrevoir quelques dents fêlées. Je danse un instant, entraîné par des bohémiennes qui rythment de leurs pieds nus le sol de terre battue. À bout de souffle, je me retire de la ronde qui s’est créée naturellement et écarte de lourds rideaux afin de rentrer dans une bicoque. Des tapis persans aux tons chauds sont superposés les uns sur les autres. Des objets variés sont disposés sur des tables en bois, des étagères, des consoles. On y trouve des peaux d’animaux, des amulettes, des encens, des bijoux et des tissus colorés. Des pots en métal débordent d’herbes séchées, j’en reconnais certaines de l’atelier de Séverin.
Une femme se tient au centre de la cahute. Elle a de longs cheveux noirs qui lui descendent jusqu’aux fesses. Ses traits sont anguleux et ses joues excessivement creusées. Son regard, de la même nuance que sa crinière, fait cohabiter inquiétude et fascination. Je m’approche de la chiromancienne qui, en silence, attrape mes mains. Tout en caressant mes paumes, elle me conte le récit de José Arcadio Buendía, comment il a engendré Aureliano, qui engendra Aureliano José ; elle me conte l’histoire passionnée et recluse d’Arcadio et de Santa Sofia de la Piedad, la solitude sans faille d’Amaranta et la tendance incestueuse de leur ménage. J’ai beau avoir lu ce roman plusieurs fois, cette généalogie compliquée et étonnante nécessite une connaissance aussi rigoureuse que celle du latin ou du grec. La femme aux yeux de jais m’apprend s’appeler Pilar. Elle fait glisser depuis l’une de ses poches un baume qu’elle masse du bout des doigts avant de me l’appliquer sur les mains. Ses yeux noirs fixent une ligne à laquelle elle seule semble avoir accès. Elle me sourit.
– Je savais bien que vous étiez une chimère. Votre espagnol est étrange, même pour un étranger.
Elle m’observe avec un sourire ému.
– C’est rare. C’est très rare, répète-t-elle sans me quitter du regard.
Pilar secoue la tête et ferme les yeux afin de recouvrer ses esprits. Elle me dit voir la mer, un engin de métal bruyant, un liquide épais, un homme aux cheveux bouclés, des rires. Je la remercie, lui prie de m’excuser de n’avoir rien pour régler ses services et me dirige vers les épais rideaux verts. Elle m’arrête alors et m’indique une autre sortie qui se trouve au fond de la tente. Je déplace les étoffes.
Je me trouve alors sur la banquette arrière de la Fiat Panda de Raphaël. La ceinture me scie la gorge. Je vomis sur les motifs du tissu vieilli et me relève difficilement. Raphaël m’observe dans le rétroviseur.
– Bordel, Paul ! Tu vas enfin revenir parmi nous ou merde ?
La voiture longe la côte, je regarde la mer. Je bafouille que ça va, que je suis là. Je lui demande ce qui s’est passé. Mon ami rit, se fout de moi, et comme j’insiste, il m’explique que j’ai passé la semaine à parler aux murs et aux objets, à pleurer allongé par terre dans le salon ou encore à fixer, immobile, effrayant, les autres. Nous sommes sur le chemin du retour. Je reprends mon travail à l’usine demain. J’aurai, toute ma vie, une violente tendresse pour Oléron 2014.
*